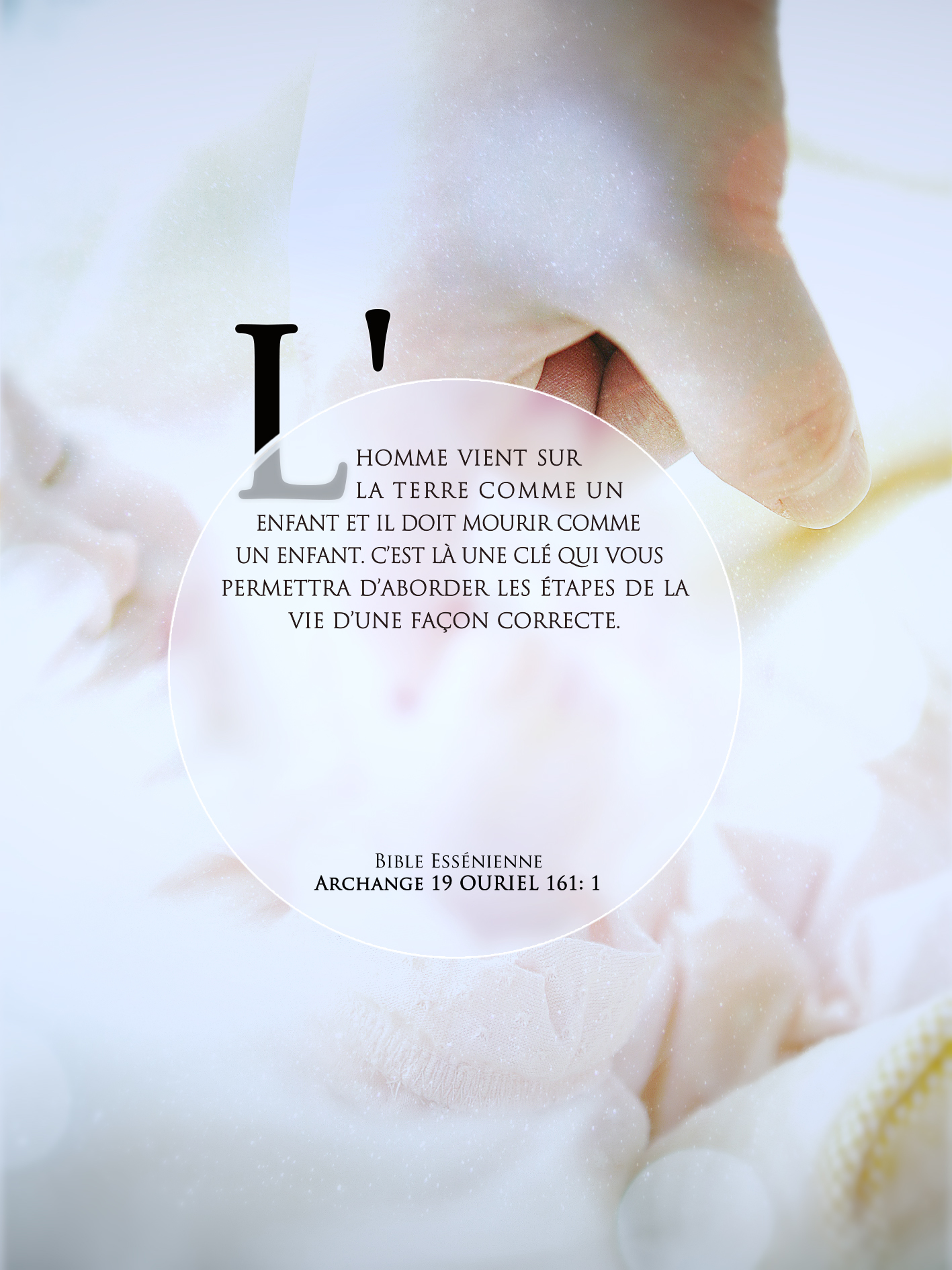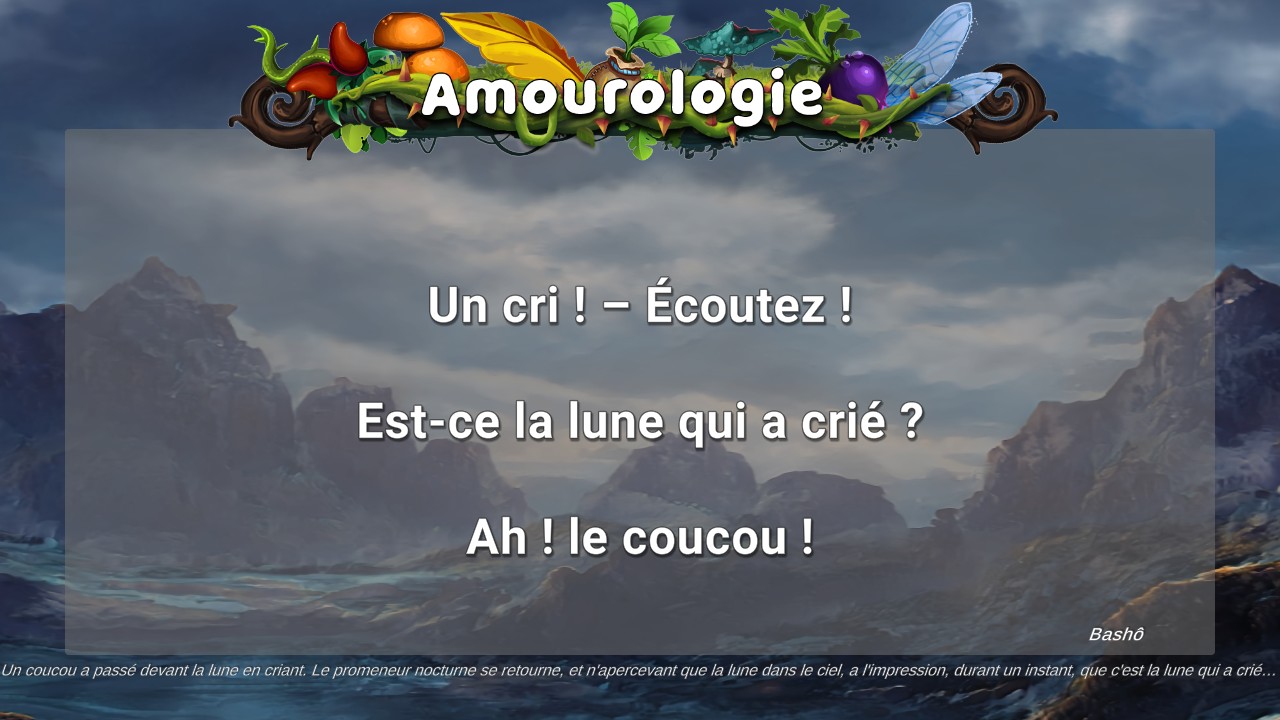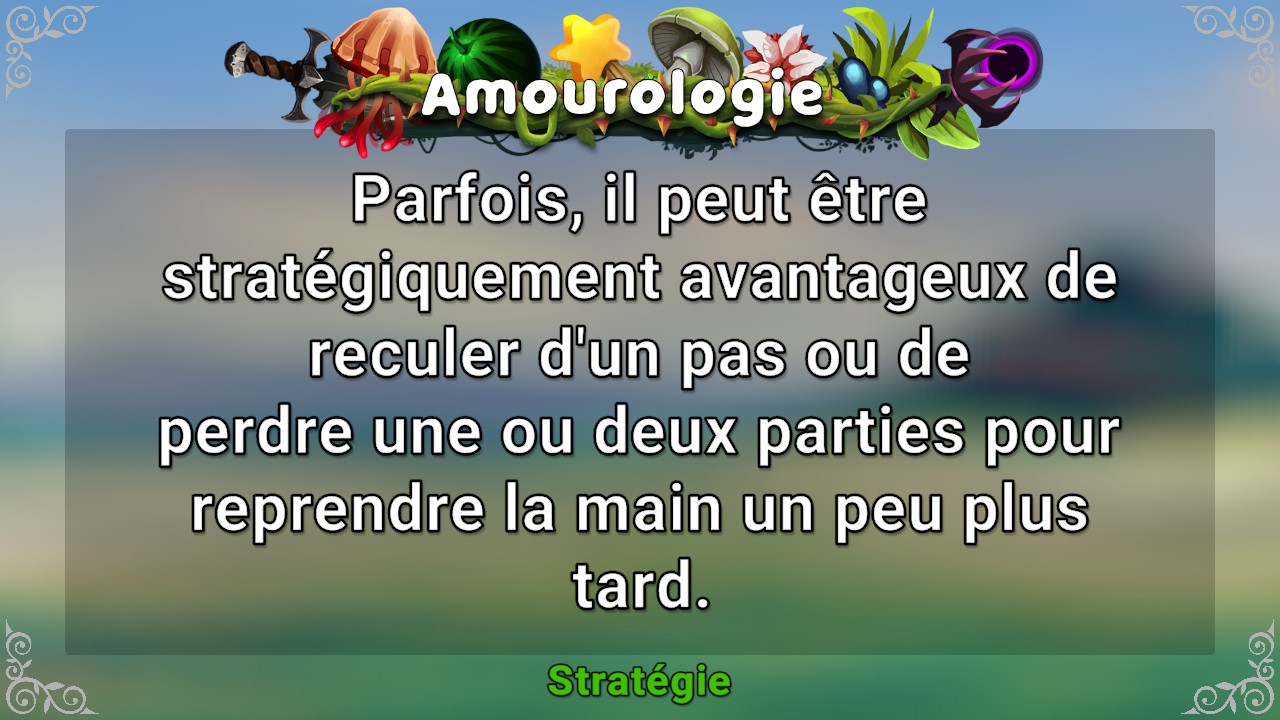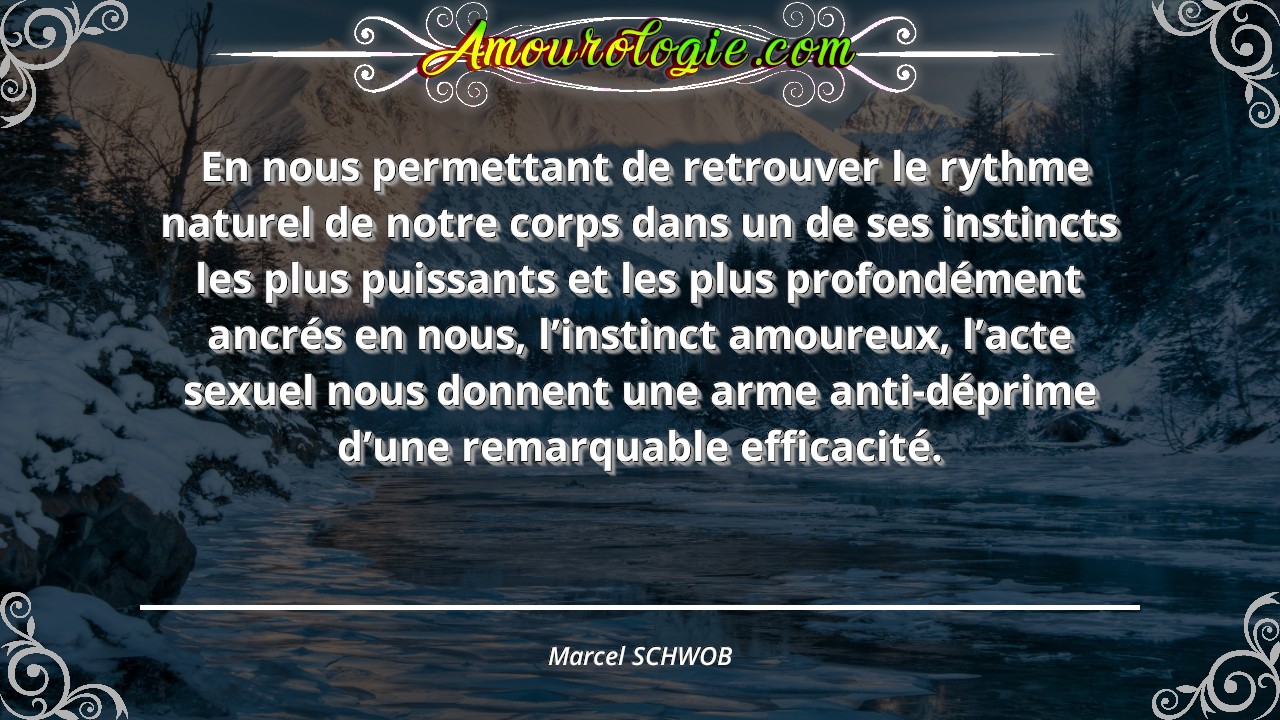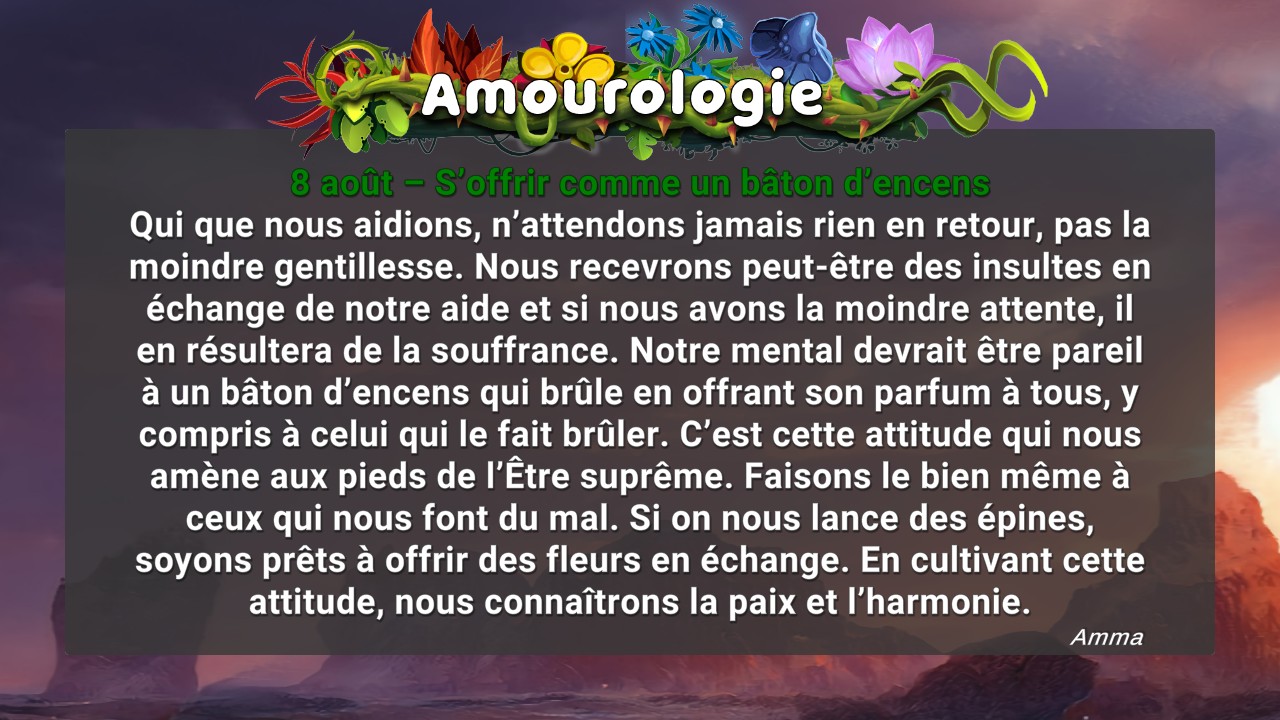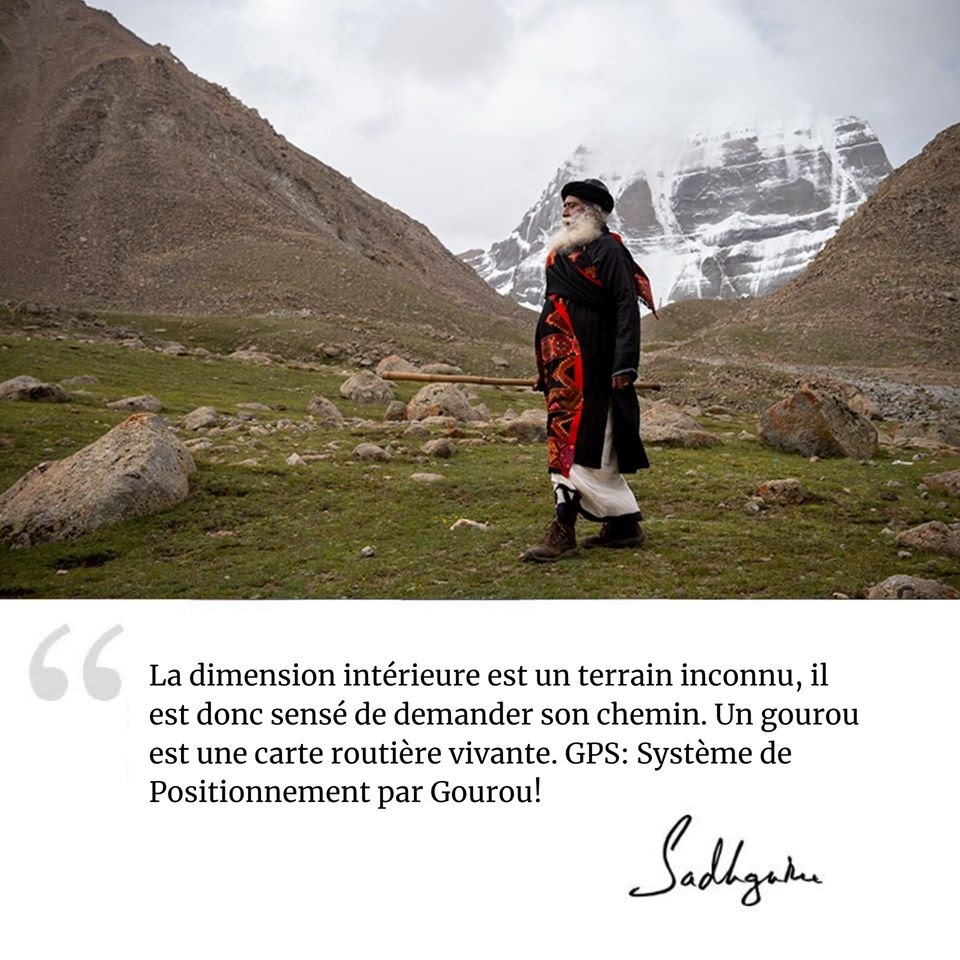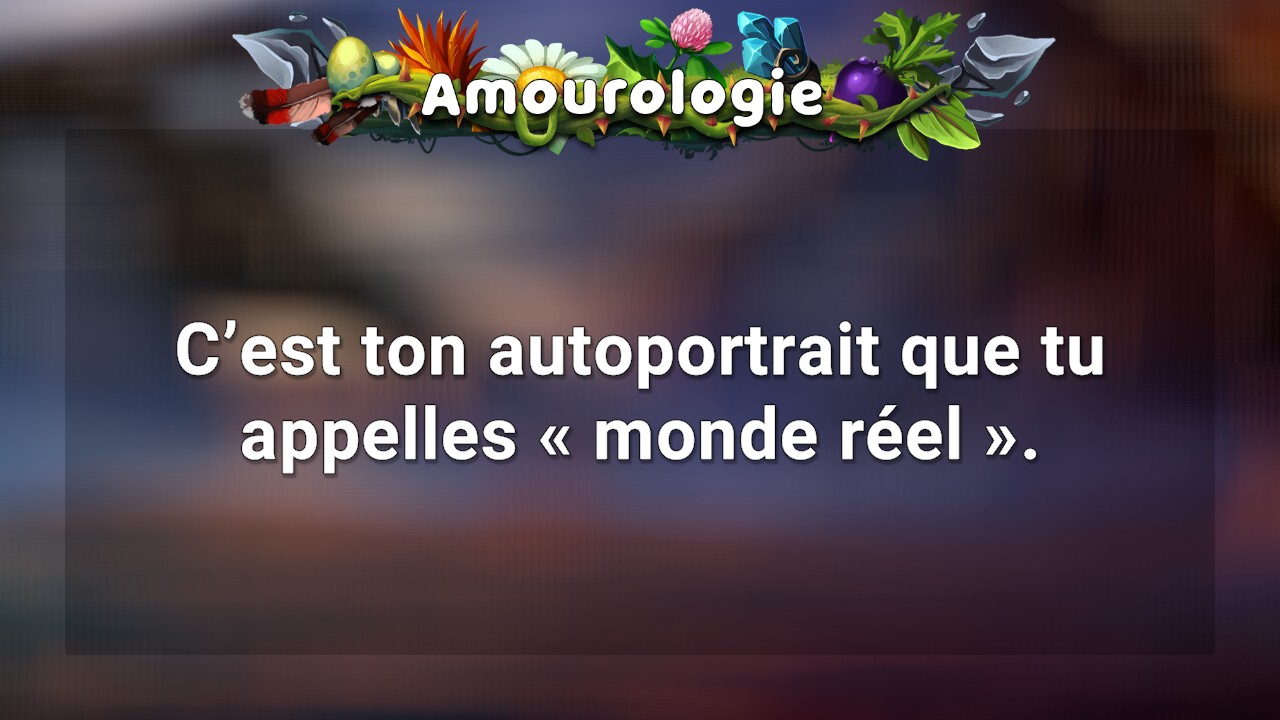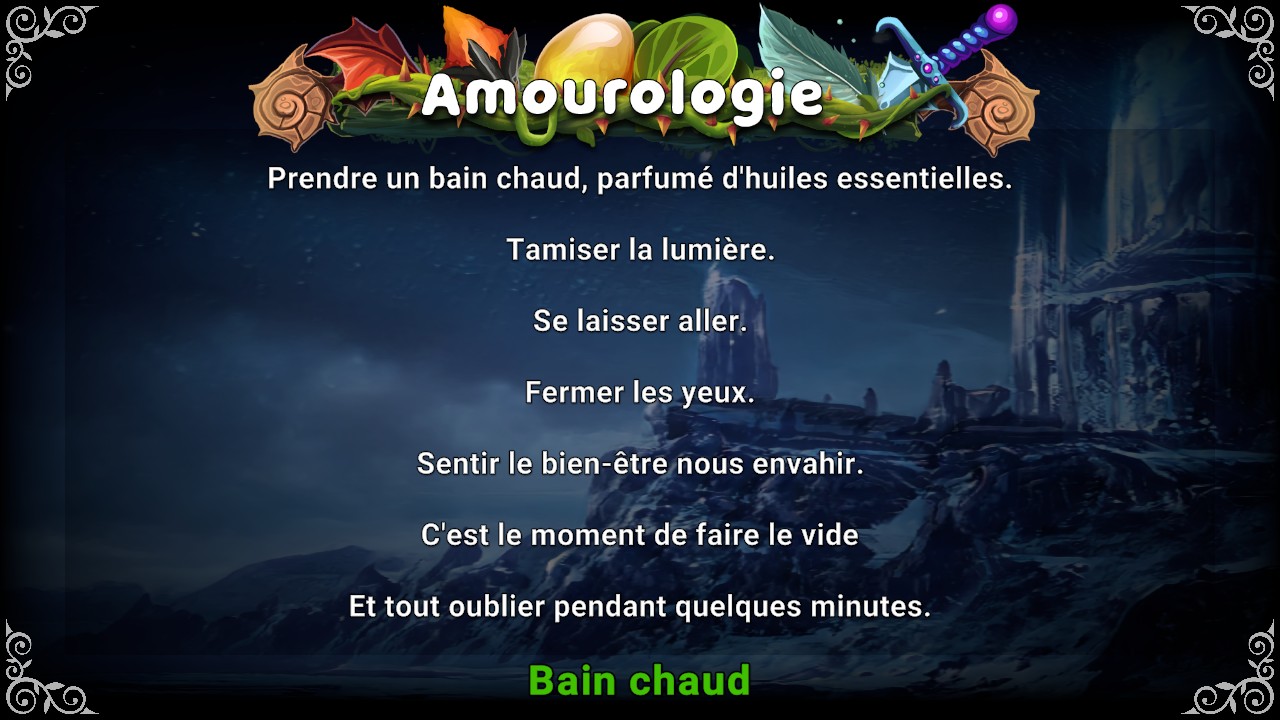- Diversité de l’Amour : L’amour n’est pas seulement romantique mais peut être fraternel, amical, familial, etc. Il n’est pas réductible à une seule forme, comme le couple hétérosexuel et monogame souvent mis en avant.
- Construction Culturelle : L’amour romantique tel que nous le connaissons est une construction récente, influencée par des facteurs culturels et sociaux. Il n’est pas universel et varie considérablement d’une culture à l’autre.
- Évolution Historique : L’amour et le mariage n’ont pas toujours été liés. Historiquement, le mariage était souvent une question de statut social et d’intérêts économiques plutôt que d’amour.
- Rôles de Genre : Les relations amoureuses sont marquées par des asymétries de genre, où les attentes et les rôles sont souvent genrés. Les femmes sont souvent plus expressives émotionnellement, tandis que les hommes sont encouragés à la retenue.
- Influence de la Pop Culture : Hollywood et d’autres formes de médias ont contribué à façonner notre vision de l’amour comme quelque chose d’incontrôlable et passionnel.
- Amour et Société : L’amour est profondément enraciné dans les structures sociales et politiques. Il peut être utilisé comme un outil de contrôle social ou de domination.
- Réinvention de l’Amour : Le texte invite à repenser et à réinventer l’amour en prenant conscience des schémas culturels et sociaux qui le façonnent. Il suggère que l’amour peut être déconstruit et réinventé pour correspondre à nos aspirations individuelles.
-Ah l’amour !
Comme le disait Georges Sand,
il n’y a qu’un bonheur dans la vie,
c’est d’aimer et d’être aimé.
Et on dit aussi l’amour vaincra toujours,
le cœur a ses raisons
que la raison ne connaît pas,
et même « All you need is love »,
ou encore…
[Aimer – Roméo et Juliette]
Aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau.
[Bruit de pet]
On parle d’amour tout le temps, le cinéma
raconte l’amour, la musique chante l’amour,
l’amour fait couler tellement d’encre,
de larmes et de salive,
tout le monde a des théories sur l’amour
et des histoires à raconter.
Il paraît même qu’il serait
incontrôlable, inexplicable,
et que finalement,
tout le sens de la vie résiderait
dans le fait d’être aimé.
Et que celui qui n’aime pas,
passe à côté de la vie.
Et même, il est aussi la raison
de toutes les souffrances,
et la justification de tous les sacrifices.
En fait, l’amour régit
nos vies humaines.
C’est un sentiment si puissant, qu’il
transcende les différences, les cultures,
n’a pas de règles, pas d’âge, est aveugle.
Bref, est une évidence.
[Carmen – Bizet – Maria Callas]
L’amour est enfant de bohême,
il n’a jamais, jamais connu de loi.
-Mais est-ce vraiment si simple ?
Aimer signifie-t-il vraiment la même chose
partout dans le monde ?
Sommes-nous sûrs de comprendre
ce qu’est réellement l’amour ?
Voilà donc le grand sujet qui agite
l’humanité depuis toujours à ce qu’il paraît.
C ‘est quoi l’amour ?
[What is Love – Haddaway]
Pour tenter de trouver la réponse,
dans cette vidéo
on va remettre tout ça en question,
et explorer l’amour
sous un angle inattendu.
Et peut-être qu’au passage, on va même
débunker des idées reçues, ou pas.
Alors, l’amour est-il vraiment
un phénomène universel ?
Ou une simple construction culturelle ?
Pour percer le plus grand secret de
l’histoire de l’humanité, surtout, restez là.
Mais attention,
d’ici la fin de cette vidéo,
vous pourriez voir votre vision de l’amour
totalement bouleversée.
[Générique – Musique ambient]
[…]
Un petit mot, avant tout, pour vous remercier
d’être toujours plus nombreux par ici,
et pour vous inviter à vous abonner,
si ce n’est pas toujours fait,
mettre un like et un commentaire
pour la force et le référencement.
C’est grâce à ça
que la chaîne peut grandir,
et qu’on peut vous proposer
des vidéos de toujours meilleure qualité,
ou au moins essayer.
Pour ceux qui veulent soutenir
le développement de la chaîne,
ou pour juste me donner un petit tips de
remerciement pour la vidéo,
vous avez les liens vers mon Tipeee
et mon Ulule dans la barre d’infos.
Et sur ce, on attaque direct,
car il y a tellement de choses à dire,
j’espère que vous êtes prêts.
Et d’ailleurs, si vous voulez
approfondir un point,
ou si un truc titille votre curiosité
pendant la vidéo,
je rappelle que toutes les refs et
les sources sont aussi en barre d’infos.
[Musique douce]
[…]
L’amour étant donc, à ce qu’il parait,
une évidence, un sentiment universel,
partagé par toutes les cultures sur Terre,
alors ça serait logique que l’anthropologie,
qui est donc la science de l’humain,
s’y intéresse depuis longtemps, non ?
Eh bah figurez-vous que…
Pas du tout !
-« On s’en bat les couilles ! »
Comme c’est le cas
pour la plupart des émotions,
les sciences humaines ont totalement
mis l’amour de côté.
Les émotions,
c’est trop irrationnel et subjectif
pour être traité
comme un sujet sérieux.
Et nous, les scientifiques,
on est des gens sérieux !
Et on préfère les sujets
bien rationnels,
comme par exemple
la politique, l’économie ou le pouvoir.
Et puis surtout,
l’anthropologie ayant, dans ses débuts,
bien du mal à être vue par le grand public
comme une vraie science entre guillemets,
elle devait assurer sa légitimité
face aux sciences dures.
Est-ce que l’opinion publique
a vraiment évolué sur ce point ?
Telle est ma question.
J’espère que oui !
Et donc, éviter ces sujets considérés
comme « pas trop sérieux ».
L’amour, c’est pas quelque chose
du domaine de la raison et du savoir.
Et donc, c’est pas un truc de sachant,
quoi !
D’ailleurs, parler d’amour et de sentiments,
c’est plutôt vu comme un truc de gonzesse.
Bon, sauf quand ça vous permet d’être
un grand poète, mais vous avez compris.
A l’époque, les sujets liés à l’affect ou au
relationnel, étaient associés à la féminité.
Et enfin, il y a aussi
toute une histoire coloniale, raciste,
derrière la fondation des sciences humaines,
et particulièrement de l’anthropologie,
avec les premiers anthropologues européens,
partant étudier des cultures non-européennes,
et qui réduisaient en général les intimités
non-occidentales à leur simple sexualité.
En fait, en observant juste des comportements
et sans vraiment chercher à comprendre
ce qu’il y a dans la tête des gens.
Position particulièrement déshumanisante,
soit dit en passant.
-« Cet animal ne fait pratiquement rien… »
-Certains ont tenté, comme Georges Balandier,
qui trouvait qu’on ne savait vraiment rien
sur l’intimité affective
des populations du monde,
et qui avait proposé à une revue scientifique
reconnue de faire des publications là-dessus.
Mais ça lui a été refusé,
parce que…
-« On s’en bat les-«
-Parce que c’était pas
un sujet sérieux.
Mais par contre, l’anthropologie,
elle s’est quand même toujours intéressée
à la généalogie, la parenté, les alliances,
et en fait elle a un immense corpus
sur les systèmes de mariage
à travers le monde.
Et donc, les ethnographies de l’époque
ont relevé que les mariages dans le monde,
répondaient souvent à des normes
de parenté, de caste, de classe,
et que les sentiments personnels
là-dedans…
-« On s’en bat-«
-Bah ça compte pas vraiment.
Et de ce fait, que les comportements
amoureux dans ces sociétés-là
étaient beaucoup plus libres qu’en Occident,
où l’amour est supposé n’exister
que dans la sphère du mariage.
Ou en tout cas du couple,
conjugal, monogame, machin.
[Confessions nocturnes – Diams, Vitaa]
Mon mec se tape une autre femme, ouais.
Et puis, à partir des années 80-90, on voit
naître un intérêt grandissant pour le sujet,
et les études sur l’amour,
vont débarquer petit à petit.
La sociologie, typiquement, elle s’intéresse
depuis un bon moment déjà au mariage.
C’est un sujet poncé dans tous les sens,
et on sait très bien pourquoi on se marie,
avec untel, ou avec un autre,
et on a essoré toutes les interrogations
autour des logiques sociales
qui se cachent derrière le mariage.
Et en gros, la théorie à la base,
c’est plutôt « qui se ressemble s’assemble »,
mais c’est un sujet qui n’est jamais
terminé car, par exemple,
la moitié des couples avait exactement
le même niveau d’études dans les années 70,
et aujourd’hui on est plutôt sur un quart.
Et les personnes, avec le bac
ou un diplôme supérieur,
mariées à celles qui n’avaient pas le bac,
sont passées de 1 à 8% sur la même période.
Et puis aussi avant, les messieurs
étaient plus diplômés que les femmes,
et maintenant ça s’est inversé, mais
ça c’est aussi parce que sur la même période,
on est passé d’environ 45% de femmes
avec le bac à 85% de femmes avec le bac,
alors que pour les hommes, c’est toujours
plus ou moins 70% d’hommes qui ont le bac.
Enfin quand même globalement,
les diplômés des grandes écoles,
ils se marient avec des diplômés de
grandes écoles, les riches avec des riches,
les classes moyennes avec
des classes moyennes…
C’est beaucoup trop long,
vous avez compris.
Tout ça pour dire que,
je ne sais pas si vous avez remarqué,
mais tout ça, ce n’est pas vraiment
des études sur l’amour en tant que sentiment,
mais, encore une fois, plutôt sur l’amour,
comment il est institutionnalisé.
Et donc, sur le couple conjugal, hétéro,
monogame, avec projet à long terme, mariage,
pavillon en banlieue, enfants, crédit,
lave-vaisselle, labrador, monospace…
Classique. Basique.
C’est chiant !
Et pourtant l’amour, ça ne se réduit
finalement pas à ça.
Qu’est-ce qu’on fait de l’amour fraternel,
amical, familial, filial, religieux,
ou même pour les non-humains, les animaux,
les objets, les pratiques, et tout ?
L’amour romantique de couple reste capital,
lorsqu’on évoque l’expérience de l’amour,
alors que ce n’est qu’une forme
parmi tant d’autres.
Et peut-être même pas
la plus importante d’ailleurs.
Et ça s’observe, du coup,
aussi dans les études.
C’est finalement plutôt le couple hétéro
et monogame qui est étudié,
face à toute la diversité
du fait d’aimer.
[Musique douce]
[…]
Petit à petit, on voit des approches en
sciences sociales de l’amour émerger,
des recherches proposant d’étudier diverses
conceptions de l’amour à travers l’humanité.
Et une étude en 1992 a même montré qu’on
trouvait des marques d’amour romantique,
donc des poèmes, des chants,
des récits, des trucs comme ça,
dans 85% des cultures,
sur 166 peuples étudiés.
Mais ça ne signifie pour autant pas du tout
que ça ressemble à notre vision de l’amour.
D’autres études ont tout simplement
compilé les mœurs amoureuses
dans différentes sociétés humaines,
et ont montré surtout, et avant tout,
qu’il y a une vraie dissociation, en réalité,
entre le mariage et l’amour.
En exemple, parmi des milliers d’autres,
les maris baloutches en Iran,
pour qui l’amour, c’est le sel de la vie,
et qui le célèbrent
dans plein de créations culturelles, poèmes,
musiques et tout ça, eh ben pour eux,
l’amour ça n’existe que en tant que relation
extra-conjugale, donc en dehors du mariage.
Et aussi de façon plutôt chaste.
Parce que oui, la vérité c’est que,
dans la plupart des cultures du monde,
amour et mariage, c’est dissocié.
En Occident, par contre, l’amour est la base
du couple, et donc de l’éventuel mariage.
Sauf qu’en fait, chez nous aussi,
ça a très longtemps été dissocié,
et selon les historiens, l’amour romantique
de couple, avec le mariage et tout,
c’est une invention extrêmement récente.
Ils disent que, selon Saint-Augustin,
aimer son épouse « avec passion »…
-« Est-ce que tu baises ? »
-C’est commettre le péché.
Dans les poèmes du Moyen-Âge,
l’amour est chaste,
et encore une fois,
il n’a rien à voir avec le mariage.
Par le passé, on se mariait en fonction
du statut social ou des intérêts, et ce,
même dans un passé très proche.
Et la famille, comme institution,
ça arrive au début du XVIIIᵉ siècle.
Comme une espèce de cellule sociale pour
représenter un groupe d’individus
pendant la fondation de la République.
Comme un espèce de clan officiel.
Et si l’amour ne se manifeste pas partout
de la même manière, eh bien,
c’est pas que par rapport
au mariage, etc.
Même les gestes d’amour
ne sont pas universels.
Genre, s’embrasser, dans notre imaginaire,
c’est le point culminant de l’histoire.
On a tous attendu pendant 5 saisons
le bisou entre Pedro et Lola
dans Un Dos Tres,
alors qu’ils s’aiment depuis l’épisode 1 !
On a tous vu ces films où on attend tout
le film le bisou entre les protagonistes,
alors qu’on sait qu’ils s’aiment,
depuis le début.
Il a une charge symbolique de ouf
dans l’imaginaire collectif.
Mais pourquoi ça serait un signe d’amour,
en fait ? Le bisou, il a une histoire.
En Occident, il est progressivement devenu le
symbole du romantisme et de la passion, etc.
Mais au Moyen-Âge, c’était un signe
de loyauté et d’allégeance.
À l’époque victorienne, c’était une pratique
qui se faisait que dans l’intimité.
Vers le XVIIIᵉ, XIXᵉ, c’est devenu
un symbole d’amour comme on le connaît, nous.
Et encore aujourd’hui, il sort parfois
du cadre de l’amoureux,
avec, genre, les bisous de soirée.
Et dans d’autres cultures, comme au Japon,
le baiser en public est plutôt inapproprié.
Même si sous l’influence occidentale, les
nouvelles générations l’adoptent peu à peu.
Autre exemple, en Inde, où on a vu les
premiers bisous dans les films bollywoodiens
au début des années 2000 seulement.
Il y a l’exemple des pays nordiques,
où le baiser est un signe d’affection
et pas forcément de relation amoureuse.
Il y a certains groupes ethniques qui
s’embrassent juste pas sur la bouche.
Qui ont peut-être d’autres formes
de contact physique,
comme le frottement du nez,
le kunik chez les Inuits,
le fameux baiser esquimau.
Mais n’utilisez pas ce terme, c’est raciste !
En fait, le bisou, c’est peut-être très
intime, mais c’est surtout très social,
dans le sens où ça relève
d’un code implicite.
On a l’impression que c’est naturel,
mais en fait, c’est purement culturel.
Et donc forcément, ça n’a pas la même place,
et ça ne veut pas dire la même chose partout.
C’est pareil pour le toucher.
Le câlin, c’est un geste affectif avant tout.
Mais en fait, c’est la manière de le faire
qui va être modelée par la culture.
Ou même le regard, ou le sourire, qui
expriment, dans des sociétés asiatiques,
de la déception, ou de l’embarras.
Je suis sûre que vous avez déjà
entendu ces exemples, de toute façon,
où on vous dit qu’il ne faut pas faire des
gestes, ou des trucs comme ça,
dans d’autres cultures, parce que
ça peut être offensant.
Car ça ne veut pas dire
la même chose que pour nous.
En fait, à la base, il n’y a pas de manière
de s’aimer qui soit universelle.
Et, dans la vidéo sur Pocahontas, il y a
quelques personnes qui n’ont pas compris,
quand j’ai dit que l’histoire d’amour
fantasmée entre John Rolfe, John Smith,
ou en fait, n’importe quel John
et Pocahontas était impossible,
parce qu’ils ne partagent pas
la même culture.
Oui, de nos jours, dans un monde globalisé,
à l’occidental, ça existe, c’est possible.
Je suis moi-même issue
d’une union multiculturelle.
L’amour étant avant tout un langage, il faut
comprendre un minimum le langage de l’autre.
Et je ne parle pas de langage littéral,
mais de langage implicite, de codes,
de manières de se comporter, comme le bisou,
le câlin, le regard, les rapports intimes…
Et à l’époque des premiers conquistadors
en Amérique du Nord,
l’asymétrie culturelle et sociale
qu’il y avait entre Pocahontas et les John,
ça rend quand même la possibilité
d’une histoire d’amour,
au sens où un occidental entendrait l ‘amour,
du coup, très peu probable.
Même si, bien sûr, ça n’exclut pas l’idée
d’une affection ou d’un attachement.
[Musique ambient]
[…]
Mais alors, d’où vient notre vision
de l’amour ?
Ce fameux grand Amour où deux personnes
seraient faites l’une pour l’autre ?
Cette force irrépressible, incontrôlable,
qu’on imagine, du coup, universelle ?
Parce que, même au sein de notre propre
culture, c’est pas du tout un universel.
Une étude a été menée par des sociologues,
sur des personnes âgées,
à propos de leur trajectoire amoureuse.
Ceux-ci n’évoquent pas vraiment de relations
soumises à des sentiments incontrôlés,
ils ne se focalisent pas vraiment non plus
sur la recherche de bonheur.
Et, au contraire, leur discours,
il est plutôt super pragmatique.
Alors, c’est sûr, il ne faut pas oublier que
l’expression publique des sentiments,
c’est un truc apparu extrêmement récemment,
avec l’individualisme, en gros,
la montée en importance
de ses propres sentiments.
Donc, leur discours, c’est éventuellement
lié au fait que c’est juste…
Pas des choses
que cette génération exprime.
Bon, pour nos arrière-grands-parents,
ou nos grands-parents, en général,
c’était pas vraiment le fait d’être fou
amoureux passionnément,
au sens où nous, on l’entend, qui était
vraiment déterminant, surtout au long terme.
Et il faut dire qu’avant les années 1970,
c’était assez rare, en fait,
de vivre des histoires hors mariage,
ou encore de divorcer.
Et de ce fait, les attentes ne sont pas
vraiment les mêmes.
Notamment chez les femmes, à cette époque,
où il est rarement admis de vivre seules,
où, souvent, elles ne gagnent pas leur vie,
et quittent leurs parents pour leur mari.
Donc pour bon nombre d’entre elles,
l’amour, c’est la liberté.
-« What ? »
-C’est l’autonomie.
C’est « ciao les darons » !
En fait, l’amour romantique, c’est clairement
une construction sociale et culturelle,
qui s’est imposée, particulièrement depuis la
fin du XXᵉ siècle et se répand dans le monde.
Il peut même être vu comme une idéologie,
parce qu’il a tout un patrimoine culturel,
des représentations, des valeurs,
des croyances, et tout.
Et Hollywood a beaucoup contribué à cette
vision-là, notamment avec cette idée
que tomber amoureux, ça peut pas
être un choix, que c’est pas rationnel.
C’est vraiment une image qui est véhiculée
très fort dans plein d’oeuvres pop culture.
Et je suis sûre que vous entendez beaucoup ça
autour de vous, que vous vous dites ça aussi.
Je crois que c’est le truc qu’on se dit
le plus, en fait, que l’amour,
ça se contrôle pas,
que ça te tombe dessus et tout.
Sauf qu’en fait, ça, c’est juste notre
mythologie de l’amour.
On est traversé par des schémas,
qu’on croit spontanés,
alors qu’ils sont profondément culturels.
Et en fait, ça vaut largement pour l’amour,
forcément.
L’amour, c’est pas vraiment spontané.
Roland Barthes, il disait même que
c’était avant tout une narration,
un texte qu’on écrit, mais en s’inspirant
du coup des autres textes.
On s’identifie à des modèles amoureux,
qui sont issus de notre culture,
donc de notre mythologie,
de nos mythes populaires.
Et tout ça, ça va façonner nos attentes,
nos comportements et tout.
Et puis, quand la réalité n’est pas pareille
que cet idéal, c’est la frustration, quoi !
Mais pour beaucoup, l’amour
et les gestes d’amour,
ça serait les manifestations
les plus naturelles de l’être humain.
Sauf que, comme on dit, la nature
de l’être humain, c’est la culture.
Et pour tout vous dire, il n’y a pas beaucoup
d’instincts chez l’être humain.
On a quelques besoins primaires que,
si on les assouvit pas, on meurt, en fait.
Genre faire caca, dormir,
manger, s’abriter.
Et on les assouvit de manière culturelle.
C’est pour ça qu’on fait les mêmes choses,
mais pas de la même façon, selon la culture.
Et d’ailleurs, anecdote en passant,
il semblerait que les enfants sauvages,
donc les enfants qui grandissent
hors culture, sans autre être humain,
dans la nature, avec des animaux, souvent,
eh bien, ne vivent pas d’histoire d’amour.
Et dans nos sociétés, l’amour,
particulièrement la séduction,
ça prend quand même aussi des tournures
de commercialisation de soi.
Et on vit dans une société capitaliste,
donc c’est logique.
Et le lien entre amour et consommation,
il est trop intéressant.
Parce que, au-delà du fait qu’il reflète
juste le système dans lequel on vit,
bah, sur le plan purement biologique,
les débuts d’une histoire d’amour,
ça active le circuit de la récompense,
de l’addiction,
qui envoie de la dopamine,
donc l’hormone du plaisir au cerveau.
Et la consommation, c’est un phénomène
qui active exactement le même circuit.
Sauf que, bien évidemment, au bout
d’un moment, ça s’arrête.
Quand je dis un moment, apparemment, ça peut
aller de quelques heures à trois, quatre ans.
Et le circuit hormonal revient à la normale.
L’état hormonal amoureux est terminé.
Ça ne veut pas dire
que l’amour est terminé du tout.
Mais la sensation que ça nous fait,
et que du coup, on a associé à l’amour
dans notre imaginaire de la passion et tout,
et bah ça, ça s’arrête.
Je pense qu’on a tous un ex qu’on aimait
à mourir, et pourtant, aujourd’hui,
on se demande à quelle heure
on a trouvé quelque chose.
parce qu’ils ont plus ou moins un charisme
de pigeon unijambiste sous la pluie.
En tout cas, c’est là que ça coince.
Parce que tout ça, ça veut dire
qu’on a une vision de l’amour
qui n’est pas compatible
avec notre réalité biologique
en tant qu’être humain.
L’amour doit être passionnel et tout.
Mais en même temps, il doit être infini.
Bah ça, au global, bien sûr, ça peut pas
vraiment arriver.
Même si, bien sûr, on peut
piéger notre esprit, ou juste,
tout simplement accepter,
et changer notre mode amoureux
pour quelque chose de plus stable.
Et pourtant, malgré tout ça, l’union d’amour
passionnel qui dure toujours, machin, etc.,
est globalement l’objectif recherché
dans notre monde.
Et pour de nombreuses personnes,
c’est même le but ultime de toute une vie.
Car en somme, l’amour est un phénomène,
avant tout, bioculturel.
Certes, il mobilise
des réactions chimiques,
mais il naît et il vit,
par des constructions culturelles.
On ne tombe absolument pas
amoureux par hasard.
On tombe amoureux en fonction de notre
imaginaire, notre histoire, notre culture,
et puis aussi des histoires de phéromones
etc., mais c’est pas suffisant.
C’est comme si chacun avait une grille de
lecture, plutôt inconsciente d’ailleurs,
avec toutes ces influences modulant ses goûts
et qui fait qu’on crush sur telle personne.
A l’époque, j’aurais dit
team DiCaprio ou Johnny Depp,
mais maintenant on veut plus
aucun des deux, hein.
[Musique ambient]
[…]
Mais ce qui rend vraiment
l’amour ouf,
c’est que l’importance
de ce sentiment amoureux
n’a cessé de croître
dans la société contemporaine,
alors qu’on vit à l’ère du rationalisme,
et que pour le coup, fondamentalement,
c’est pas rationnel du tout !
Vous l’avez compris, tout ça,
c’est à mettre en lien avec la société.
Parce que si l’amour semble être une affaire
privée, au final, c’est profondément social.
Et c’est vraiment intéressant de se
demander comment ces histoires d’amour
reflètent finalement nos normes sociales.
Ça montre un tas de modèles qui définissent
très clairement les rôles des amoureux.
Et vous vous en doutez, les rapports de
genre sont particulièrement intéressants
lorsqu’on se penche
sur la question de l’amour.
La sociologue Michelle Pagès s’est
beaucoup intéressée à la question.
Et cette vision de l’amour passionnel
et romantique qu’on a,
elle implique que l’amour soit donc
réciproque et non calculé.
Et en fait ça,
ça met sous le tapis
pas mal d’asymétries et d’inégalités
qu’il y a dans les relations amoureuses.
Dans les relations hétéronormées,
donc celles qui sont les plus étudiées,
il y a des attentes et des rôles très genrés.
Comme sur la question de la communication,
pourtant fondamentale en amour, en couple.
Bah ça, c’est très asymétrique,
parce que les femmes,
elles sont socialement plutôt conditionnées
à exprimer leurs émotions ouvertement
à écouter plus attentivement, et à valoriser
leur engagement relationnel, émotionnel, etc.
Tandis que les hommes, ils sont beaucoup
plus encouragés depuis l’enfance
à être dans la retenue émotionnelle, aussi à
valoriser leur autonomie, leur indépendance.
D’ailleurs, nombre d’entre eux expriment une
vraie difficulté à dire leur vulnérabilité.
Et elles, le fait qu’elles se retrouvent
à prendre pas mal en main
la charge affective de la réussite du couple.
Et ça, en fait, ce sont des rôles sociaux
attribués à chaque genre,
mais en dehors des histoires d’amour,
mais qui du coup, s’y retranscrivent aussi.
Car malgré tout, les relations amoureuses
ne sont pas exemptes
des dynamiques de pouvoir
qui existent dans la société.
En ce sens, l’amour ça serait même
un peu politique.
Pour l’anthropologue Philippe Brenot,
et pas que lui d’ailleurs,
le mariage c’est même avant tout
l’outil de la domination masculine.
Pour autant, les petites filles rêvent
de mariage et d’amour.
Et il y a aussi certaines situations où
l’amour est un outil de contrôle social.
Par exemple, ça peut être une condition
pour obtenir des papiers.
Être amoureux de quelqu’un
d’une certaine nationalité,
ça peut être un critère d’inclusion
sur un territoire.
Et parfois, il faut même présenter une
version de son couple
beaucoup plus romantique que la réalité
pour se voir accorder des papiers.
Mais pour autant, ça, pour d’autres formes
d’amour, ça n’existe pas du tout.
Quelqu’un qui demanderait une nationalité
pour vivre avec sa « bestie »,
ça n’effleurerait pas l’esprit.
Et pourtant parfois,
souvent, c’est un amour,
qui est d’autant plus stable et solide
qu’il a bien moins de contradictions en lui.
L’État intervient aussi dans
la reconnaissance de certains amours.
Dans le cas du mariage homosexuel,
par exemple, ou polygame.
L’amour, il est aussi utilisé
comme argument politique avec ceux
qui défendent la famille traditionnelle,
entre guillemets, par exemple.
Ou les conservateurs anti-polyamour.
Parenthèse ici, mais le polyamour,
c’est pas un phénomène nouveau.
Il y a plus d’un siècle, on écrivait dessus.
Ça s’appelait l’amour-camaraderie.
Il y avait des bouquins, des théories,
comme celui d’Alexandra Kollontaï.
Donc l’amour ce n’est pas juste un sentiment.
On y trouve un imaginaire culturel,
mais aussi des structures politiques,
des fonctionnements sociaux.
De toute évidence, il participe
à l’organisation sociale.
Et l’organisation sociale
le façonne en retour.
Et le couple, c’est un peu comme
un petit laboratoire social,
pour reprendre l’expression de Kaufmann,
où se rejoue un peu tout,
donc non seulement les tensions de genre,
mais aussi le rapport
entre l’individuel et le collectif.
[Musique douce]
[…]
L’amour et le bonheur, ce sont les grands
recherchés de l’occident contemporain.
Pour autant, le rapport entre les deux
n’est pas du tout clair.
Et pourtant, la plupart des gens
partent du principe que l’amour,
c’est l’ingrédient fondamental du bonheur,
si ce n’est le principal.
Et le fait que l’amour soit si important,
c’est en contradiction totale et absolue
avec nos normes idéologiques de
rationalisme absolu, scientifique, nanani.
En plus, cette forme d’amour,
qu’on s’imagine immuable, finalement,
c’est très récent à l’échelle de l’humanité.
Et à l’heure de la rencontre virtuelle,
ça va encore changer.
Le discours de l’amour, c’est juste de dire
qu’il est indescriptible et injustifiable.
Mais en réalité, l’amour, c’est une
modalité de relation comme une autre.
Et donc, c’est une modalité
de communication.
Il y a un partage de codes, des signes
et, justement, un dialogue.
Alors non, l’amour,
ce n’est pas une évidence naturelle.
Ce n’est pas non plus une illusion.
Ce n’est pas une ruse de la nature pour
assurer la reproduction de l’espèce,
comme ont pu l’avancer
certains évolutionnistes.
Mais en fait, il y a juste autant de manières
de s’aimer qu’il y a de cultures,
et non pas qu’il y a d’individus.
L’amour, en fait, est construit comme toute
émotion, pour citer le célèbre Durkheim.
Mais le principe d’un truc construit,
c’est quand même qu’il peut être
déconstruit, agrandi,
amélioré et tout, non ?
En prenant conscience de nos schémas,
on peut se permettre de les détourner,
les déjouer, les réinventer.
Et plutôt que de nier l’existence
de nos codes, autant jouer avec !
Par exemple, le célibat,
ça pourrait être un statut comme un autre,
et pas l’absence de quelque chose, une étape
transitoire ou une source de souffrance.
La passion, ça peut être vécu autrement.
Les rapports de domination
peuvent être évacués, exclus.
Et un tas d’autres exemples.
Parce que rien n’est figé,
puisque tout est construit.
Et si aujourd’hui, on inventait les histoires
d’amour qui nous correspondent ?
Parce que si l’amour n’est pas une fatalité,
ça veut dire que c’est une possibilité ?
Et vous, si vous pouviez réinventer
l’amour, à quoi ça ressemblerait ?
Si la question du couple vous intéresse,
je vous recommande
« Les sentiments du prince Charles »
de Liv Strömquist, si j’ai bien dit le nom.
Et si vous vous intéressez plutôt à l’amitié,
par exemple,
il y a « 3 » de Geoffroy de Lagasnerie,
qui est super chouette.
Si vous êtes en études de sciences humaines,
et que ce sujet vous intéresse, mais foncez !
On veut des recherches qui parlent d’amour
au-delà du couple hétéro-monogame.
L’amour est un sujet de recherche
comme un autre.
Et peut-être même encore plus que n’importe
quel autre, avec toute la place qu’il prend.