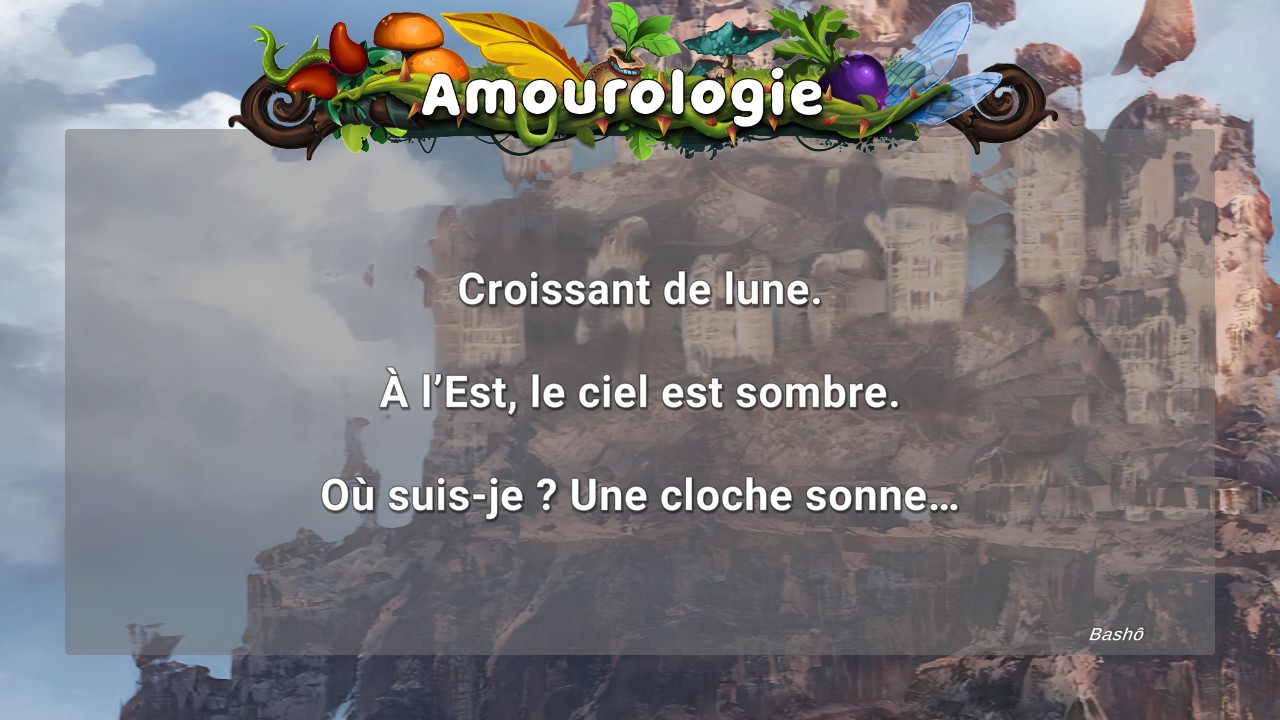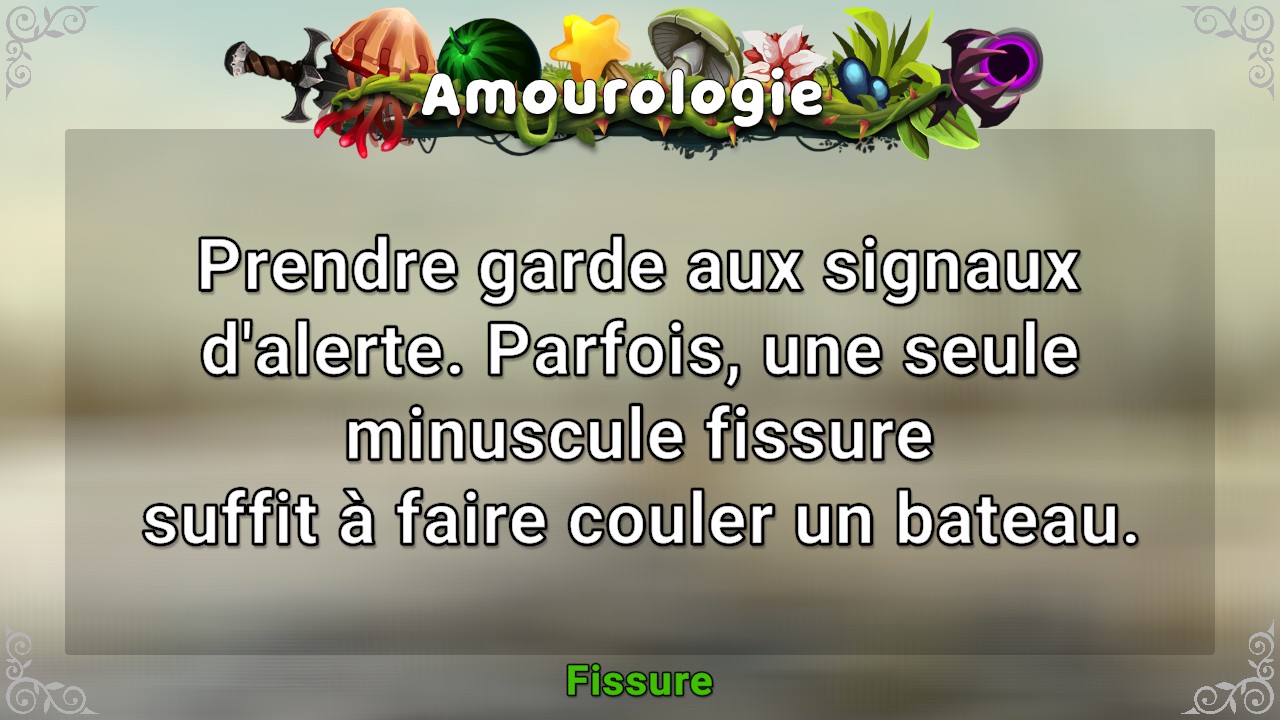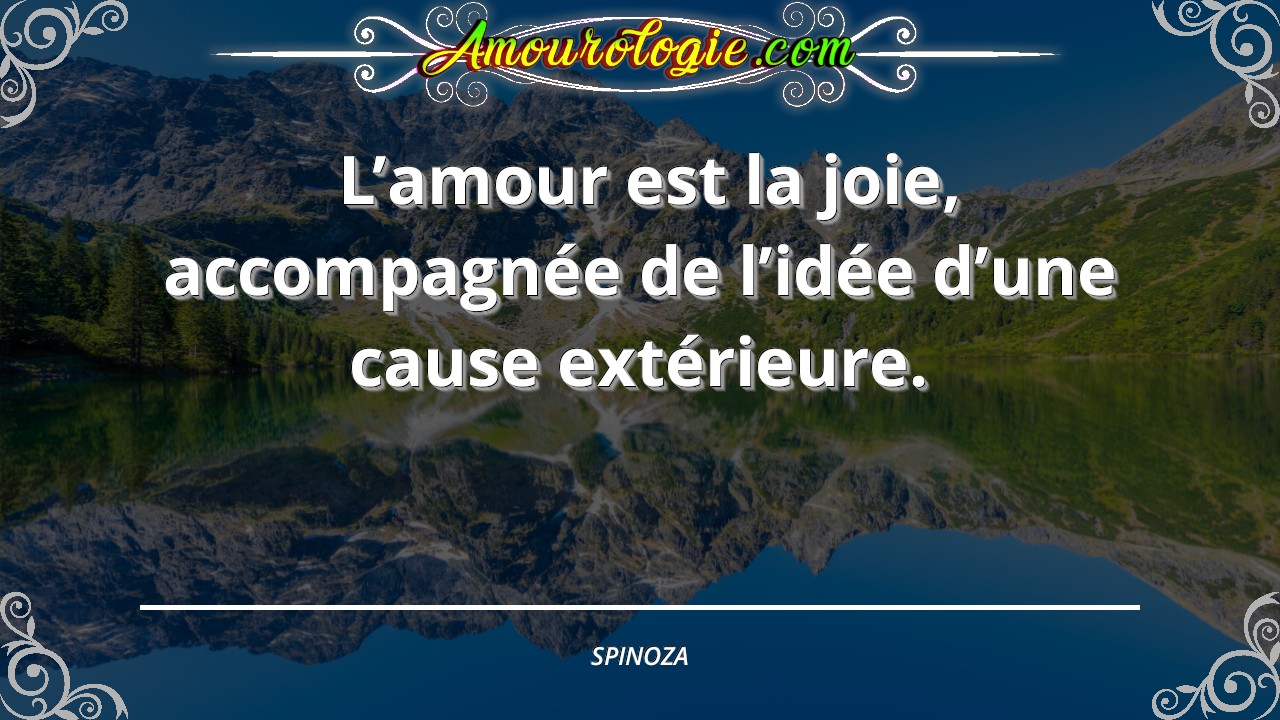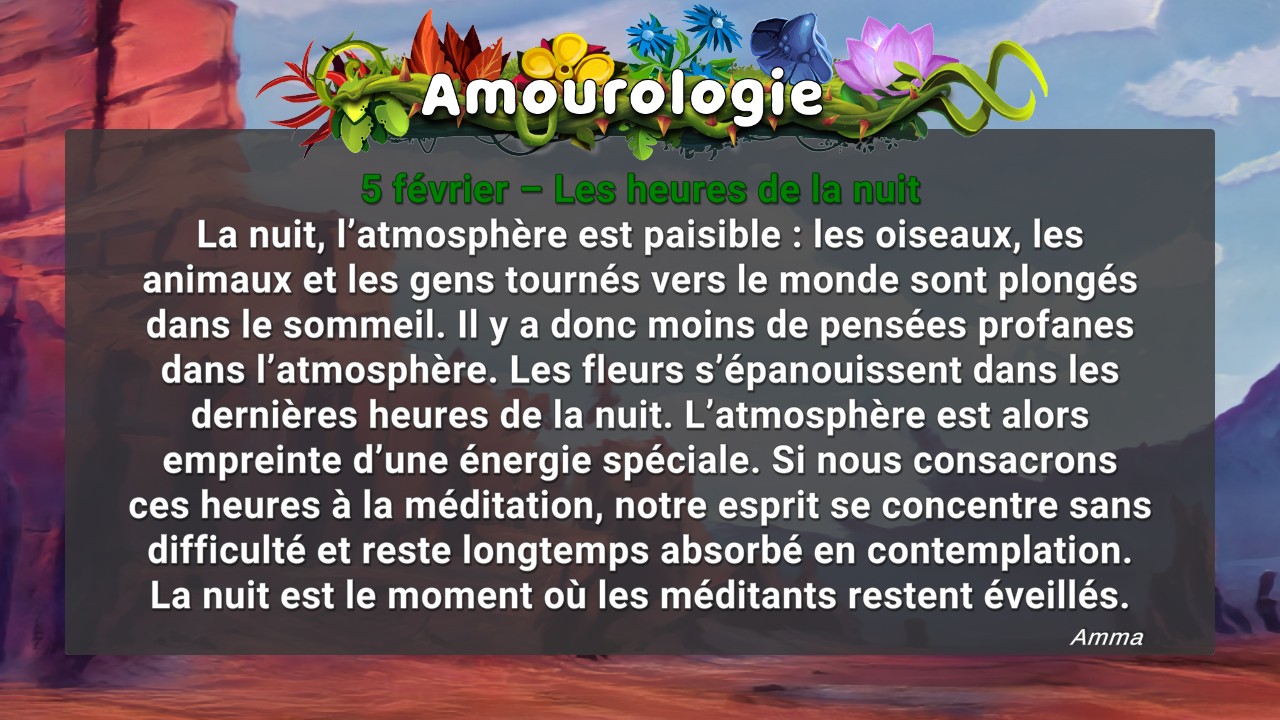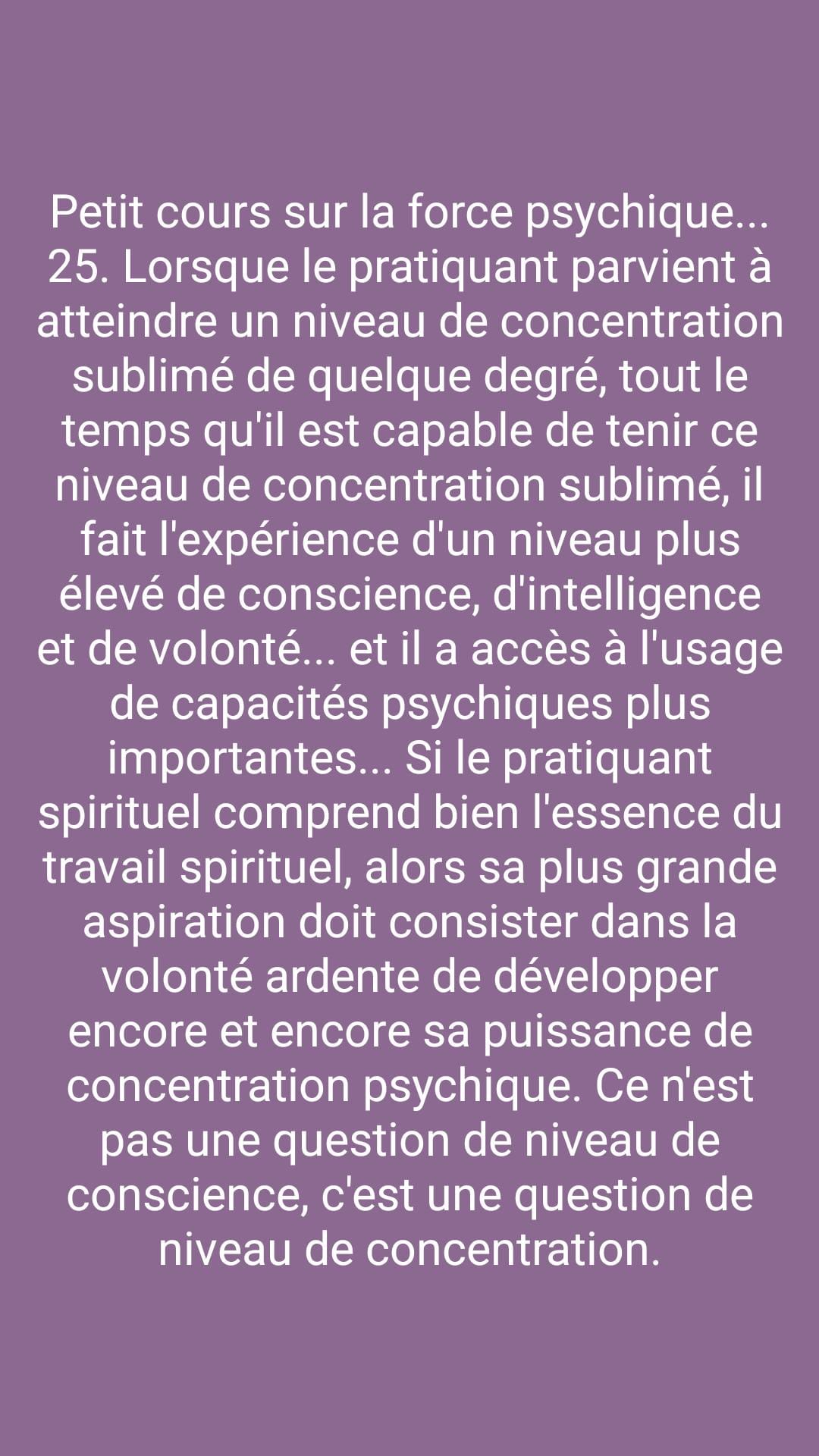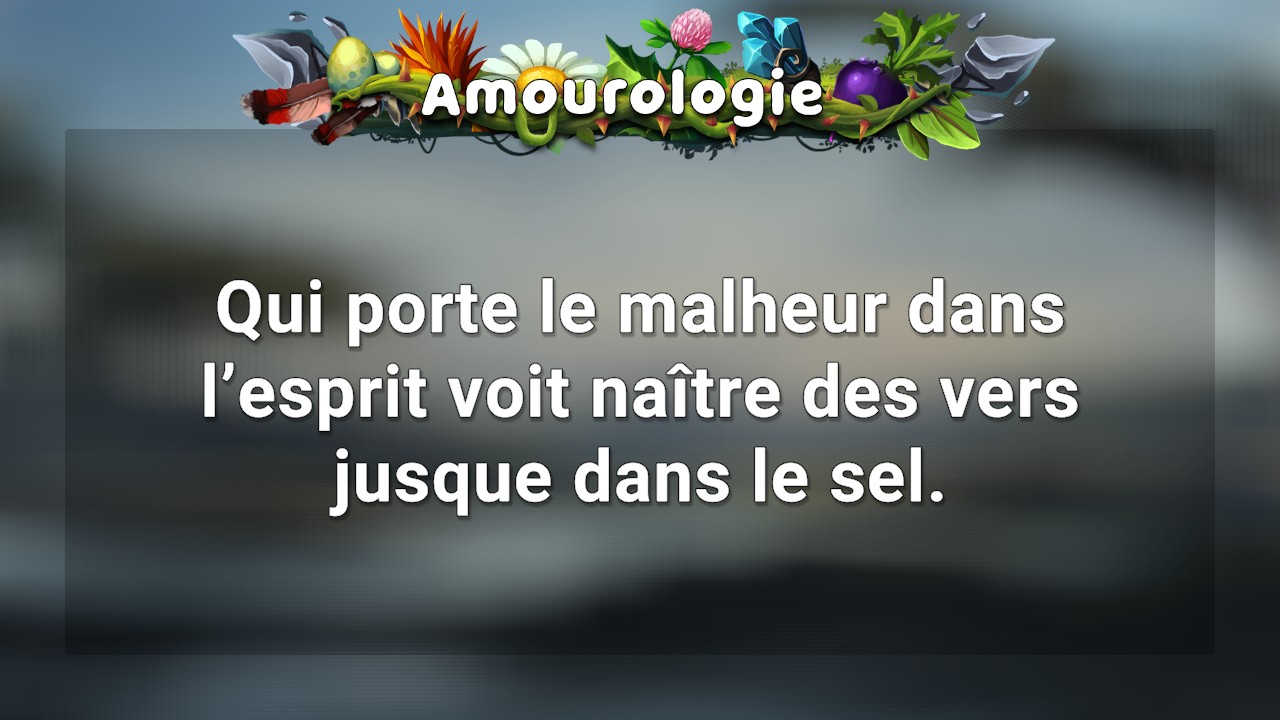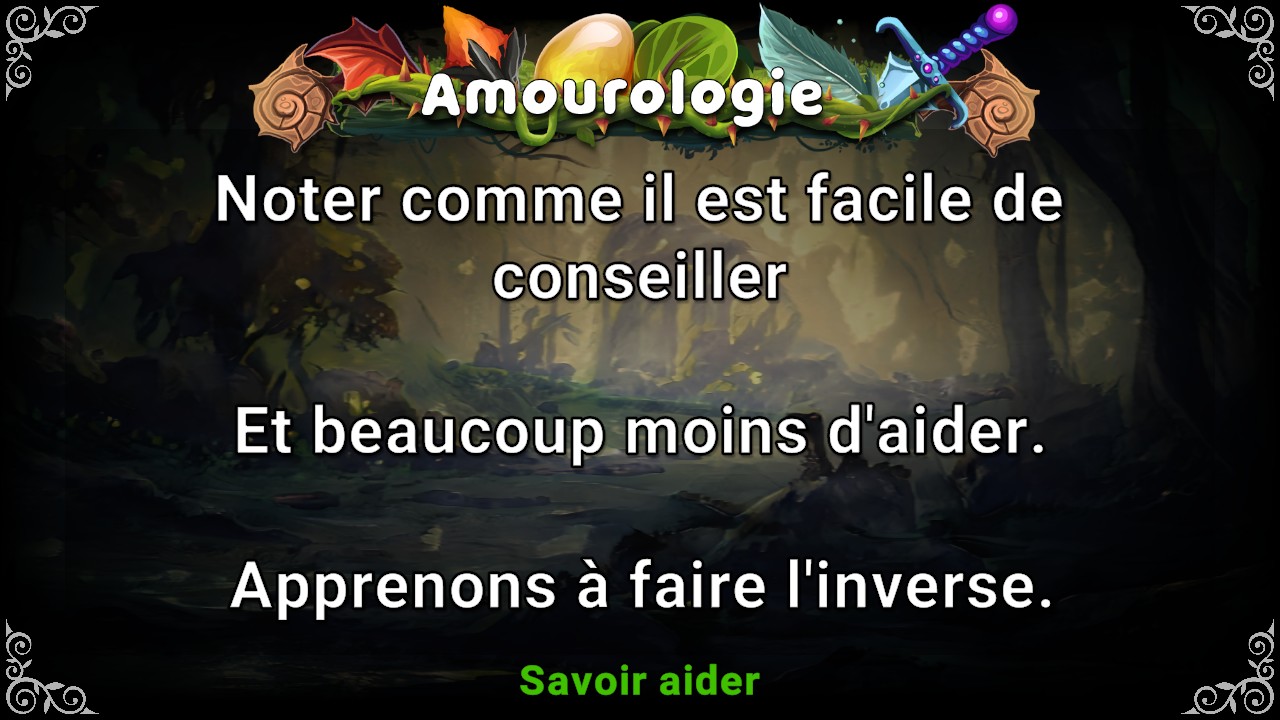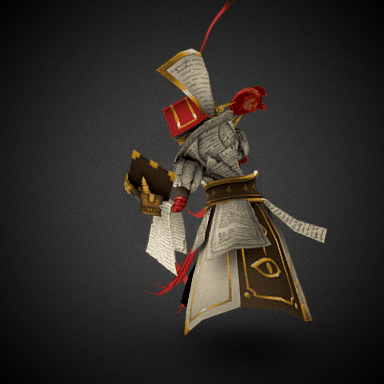
L’homme est sans force face a la femme
par la déifié qu’il attribue à l’amour
et vice versa par respect qui est leur sont du.
résulte à la fois de la sensualité et de la pitié exaltée
a ce titre l’amour ne peut qu’être tragédie
Il n’y a pas en Russie de véritable romantisme
ce qui ressort de L’œuvre de Dostoïevski
c’est que la femme représente le destin de l’homme.
L’esprit de Dostoïevski Chapitre 5 L’AMOUR
L’œuvre de Dostoïevski se déroule tout entière dans l’atmosphère orageuse et brûlante de la passion. Dans le courant complexe de la nature russe, il a dégagé et mis au jour l’élément passionnel et voluptueux. Rien de pareil chez aucun autre écrivain de son pays. L’obscure tendance ethnique qui s’était révélée dans les masses par la secte mystique des « chlisty », Dostoïevski en découvre la trace jusque dans les classes intellectuelles. C’est un courant dionysiaque. L’amour chez Dostoïevski est exclusivement dionysien. Il déchire l’individu. Le héros de Dostoïevski est voué fatalement à la souffrance. L’amour, pour lui, c’est une éruption volcanique, l’éclatement de toutes les forces passionnelles latentes dans la nature de l’homme. Cet amour-là ne connaît pas les lois et ne connaît pas les formes. Sous sa poussée irrésistible, les profondeurs mêmes de la nature humaine remontent à la surface. Le dynamisme dont est marquée toute l’œuvre de Dostoïevski nulle part n’est plus frappant qu’ici ; [138] flamme et mouvement ; feu plastique et dévorateur ; mais feu qui se transforme ensuite en un froid de glace. Dostoïevski nous montre parfois l’homme qui aime, ayant épuisé toutes les ardeurs, tombé dans une insensibilité frigide : un volcan éteint.
La littérature russe ignore les types sublimes de l’amour que l’Europe occidentale a conçus. Elle n’a rien qui ressemble à l’amour chanté par les troubadours, à celui de Tristan et d’Iseult, de Dante et de Béatrix, de Roméo et de Juliette. Le lien réciproque entre deux êtres, le culte amoureux de la femme, c’est là l’admirable fleur née de la culture chrétienne de l’Europe. Mais la Russie n’a pas vécu la chevalerie, elle n’a pas eu de trouvères. De là une irréparable lacune spirituelle qui donne à toute manifestation russe de l’amour quelque chose de pénible et de torturant, quelque chose de sombre encore et de souvent monstrueux. Il n’y a pas en Russie de véritable romantisme de l’amour, — le Romantisme étant un phénomène de l’Europe occidentale.
L’amour occupe une place immense dans l’œuvre de Dostoïevski. Mais ce n’est pas une place indépendante. Il n’a pas de prix en soi, il n’a pas de type propre : il n’est là que pour révéler à l’homme sa route tragique, pour servir de réactif à la liberté humaine. En conséquence, le rôle que joue l’amour dans l’œuvre de Dostoïevski est tout différent, par exemple, de celui que jouera dans [139] Pouchkine l’amour de Tatiana, ou dans Tolstoï l’amour d’Anna Karénine. L’élément féminin lui-même y est conçu comme un personnage indépendant. Nous verrons qu’elle intéresse Dostoïevski exclusivement comme un moment dans la destinée de l’homme, une étape sur son chemin. L’anthropologie de Dostoïevski est une anthropologie masculine. Pour lui, l’âme humaine est avant tout le principe masculin. Le principe féminin, c’est le thème intérieur de la tragédie de l’homme, son intérieure tentation. Quelles images de l’amour nous a donc laissées Dostoïevski ? L’amour de Muichkine et de Rogojine pour Nastasia Philippovna, l’amour de Mitia Karamazov pour Grouchenka, de Versilov pour Catherine Nicolaïevna, l’amour de Stavroguine pour beaucoup de femmes. Nulle part une figure sublime, un type féminin qui ait une valeur propre. C’est l’homme que torture toujours le destin tragique. La femme n’est que l’expression intérieure de ce destin.
Dostoïevski dévoile le tragique sans issue de l’amour, l’impossibilité où sont les êtres de le réaliser, de le réaliser dans les voies tracées par l’aménagement habituel de la vie. L’amour chez lui est meurtrier, comme il l’est chez le poète Tioutchev.
« Oh ! comme nous aimons d’une façon meurtrière,
Comme, dans l’aveuglement impétueux des passions,
Nous détruisons le plus sûrement
Ce qui à notre cœur est le plus cher. »
Dostoïevski ne peint ni le charme des passions, ni la beauté de la vie familiale. Il ne nous montre pas l’amour suprême qui mène à l’union totale, à la fusion. Le mystère nuptial ne se consomme pas. Il prend l’individu au moment précis de sa destinée où toutes les bases de son existence se trouvent ébranlées. L’amour reste exclusivement chez lui l’indice tragique du dédoublement humain. Elément au plus haut point dynamique, il crée autour de lui une atmosphère de feu et soulève des tourbillons : mais il n’est jamais une fin en soi. Rien n’est acquis par l’amour : c’est un ouragan qui mène à la ruine. Et pourquoi ? Parce qu’il est une manifestation de l’arbitraire humain et, comme tel, il fragmente et scinde en deux la personne humaine. Nous touchons ici au thème essentiel de l’œuvre de Dostoïevski, au tragique destin de l’homme, au destin de la liberté humaine. L’amour n’est qu’un moment de cette destinée. Destinée humaine, avons-nous dit, mais destinée de Raskolnikov, de Stavroguine, de Kirilov, de Muichkine, de Versilov, de Dimitri, Ivan et Aliocha Karamazov : et non pas la destinée de Nastasia Philippovna, d’Aglaé, de Lise, d’Elisabeth Nicolaïevna, de Grouchenka et de Catherine Nicolaïevna. Encore une fois, la femme est une difficulté en travers du destin viril, et il ne faut pas chercher en Dostoïevski le culte de l’éternel féminin. La vénération particulière qui l’attache à la terre nourricière et à la Vierge n’est en aucune façon liée chez lui aux formes féminines de son imagination et à ses représentations de l’amour. Dans le seul personnage de Marie Timoféievna, la Boiteuse, peut-être a-t-il tenté d’exprimer quelque chose de particulier, encore qu’on exagère habituellement à ce sujet, et que la figure de la Boiteuse intéresse Dostoïevski bien moins que celle de Stavroguine. En aucun cas, Dostoïevski ne fouille un caractère féminin comme Tolstoï l’a fait pour Anna Karénine ou pour Natacha. Anna Karénine n’est pas seulement un personnage doué d’une vie propre, elle est la figure centrale du livre. Nastasia Philippovna et Grouchenka ne sont que des forces, des courants qui entraînent les hommes qui leur font face. Dostoïevski serait incapable de vivre en compagnie de ses héroïnes, comme Tolstoï vit avec les siennes. Elles ne l’intéressent qu’en fonction de l’homme, sur la route duquel elles sont placées en tant que tentation et que passion. La nature démoniaque de la femme n’intéresse Dostoïevski qu’autant qu’elle éveille cette passion masculine, qu’elle provoque chez l’homme le dédoublement de la personnalité. L’homme demeure muré en lui-même, il ne s’évade pas vers un autre être, vers l’être féminin. C’est au-dedans de lui-même que le drame de la passion se livre, et la femme n’est que l’objet de ce qu’on peut appeler ce règlement de comptes intérieur.
La destinée humaine, pour Dostoïevski, étant la destinée de la personnalité, de l’élément personnel dans la créature humaine, et cet élément personnel étant selon lui surtout développé chez l’homme, on ne saurait retracer la destinée de la personnalité humaine par l’histoire d’une âme féminine. L’homme est rivé à la femme par la passion : mais cette passion, elle demeure, si l’on peut dire, affaire entre lui et sa propre personne, son propre tempérament passionné. Jamais sa passion ne le réunira à la femme choisie. Et peut-être, si Dostoïevski a peint la nature féminine toujours malade, toujours déchirée, c’est parce que, d’après lui, elle portait le poids de cette éternelle séparation avec l’homme. Dostoïevski affirme le tragique sans issue de l’amour. Il se refuse à croire, comme le grand mystique Jacob Boehme, comme d’autres aussi, que l’expression finale de la nature humaine soit l’androgyne. Le thème qu’il a voulu mettre en lumière, c’est que la femme représente le destin de l’homme. Lui-même demeurait étranger à la nature féminine et reconnaissait jusqu’au fond ce dualisme. L’être humain, pour lui, ce n’était pas l’androgyne, c’était l’homme.
Dans la tragédie de l’esprit de l’homme, la femme incarne le dédoublement. L’amour sexuel, la passion signifie pour la nature humaine la perte de son intégrité. C’est pourquoi la passion est impure. La pureté ne se réalise que dans l’unité. La débauche est aussi la désagrégation. Dostoïevski conduit l’individu à travers les méandres du dédoublement de sa propre personnalité. L’amour, chez lui, est décomposé en deux éléments ; et pour les rendre plus sensibles, l’amant aime presque toujours à la fois deux objets. Amour double, dualisme dans l’amour, Dostoïevski a rendu cela avec une force incomparable. Il révèle dans l’amour deux principes, deux courants, deux gouffres où vient s’abîmer l’individu, le gouffre de la sensualité et le gouffre de la pitié. Issu à la fois de la sensualité exaltée et de la pitié exaltée, l’amour, chez Dostoïevski, atteint toujours aux extrêmes. Et c’est par là qu’il l’intéresse. Un amour modéré serait pour lui sans valeur. Ce qu’il a voulu, c’est poursuivre des expériences sur la nature humaine, et en éprouver la profondeur en plaçant l’individu dans des circonstances exceptionnelles. L’amour se dédouble chez Dostoïevski, l’objet aimé se dédouble aussi. Aucune unité, aucune perfection dans l’amour. Il ne peut en être autrement sur cette voie de l’arbitraire, quand la nature humaine, déchirée entre deux tendances contraires, risque de perdre dans ce dédoublement jusqu’à sa figure propre. Amour-volupté et amour-pitié, les deux termes du dédoublement, ne connaissant pas de mesure, n’obéissant à aucun principe supérieur, consument, réduisent en cendres le même individu. Car, dans les profondeurs mêmes de la pitié, Dostoïevski discerne une manière de sensualité. Ce n’est pas l’être dans son intégrité que la passion mène au délire, c’est l’être dédoublé, et ce dédoublement, ce déchirement, la passion ne lui fournira pas les moyens de les surmonter. L’homme apporte dans l’amour son propre dédoublement. Mais l’amour, à son tour, l’entraîne à sa perte en le déchirant sur les pôles contraires. Par l’amour, jamais l’homme ne retrouvera son unité, son intégrité perdues, jamais, ni par la sensualité infinie, ni par l’infinie pitié, il n’arrivera à la communion avec l’objet aimé, dans laquelle seulement son être pourrait se retrouver entier. Non, il demeurera seul, jouet de ses passions antinomiques, et y ayant épuisé ses forces.
On conçoit comment, chez Dostoïevski, l’amour, qui fait parcourir à l’homme un tel cycle, est presque toujours démoniaque ; il engendre l’obsession, élevant la température de l’air ambiant jusqu’à celle du fer rouge. Non seulement ceux qui aiment deviennent fous, mais tout le milieu environnant subit la contagion de leur folie. L’amour exalté de Versilov pour Catherine Nicolaïevna crée une atmosphère de déraison, il maintient tous les personnages qui l’entourent dans un état de tension excessive. Les ondes amoureuses qui vont de Muichkine, de Rogojine à Nastasia Philippovna et à Aglaé embrasent l’atmosphère. L’amour de Stavroguine et de Lise suscite des tourbillons infernaux. L’amour de Mitia Karamazov, d’Ivan, de Grouchenka et de Catherine Ivanovna conduit au crime, dégénère en [145] folie. Et jamais et nulle part, cet amour ne trouve en lui le repos, jamais il ne conduit à la joie de l’union totale. Aucun rayonnement de l’amour. Toujours, au contraire, la vision du malheur, l’élément sombre et destructeur, la torture. Nous l’avons vu, jamais l’amour n’aide l’homme à triompher de son dédoublement, au contraire, il l’approfondit encore. Deux femmes, toujours, comme symbolisant deux courants passionnels, partent de leur amour pour se livrer un combat impitoyable, se détruisent elles-mêmes en détruisant les autres. Ainsi s’affrontent Nastasia Philippovna et Aglaé dans l’Idiot, Grouchenka et Catherine Ivanovna dans les Frères Karamazov. Il y a quelque chose de sans merci dans la rivalité et la lutte de ces femmes. Lutte et rivalité qui se retrouvent aussi dans les Possédés et dans l’Adolescent, quoique sous une forme moins accusée. La nature masculine est dédoublée ; celle de la femme est obscure encore, elle contient comme un abîme où l’homme peut tomber : mais il n’existe plus trace en elle de la mère bénie, de la Vierge bienheureuse. La faute ici repose uniquement sur l’homme. C’est lui qui s’est arraché du principe féminin, qui a renoncé à la terre maternelle, à sa propre virginité, c’est-à-dire à sa pureté et à son intégrité, et a pris le chemin de l’erreur et du dédoublement. Maintenant, il se montre sans force devant ce principe féminin. Stavroguine est sans force devant Lise et Chromonojka ; Versilov, sans force devant Catherine Nicolaïevna ; Muichkine est sans force devant Nastasia Philippovna et Aglaé ; Mitia Karamazov, sans force en face de Grouchenka et de Catherine Ivanovna. Hommes et femmes demeurent tragiquement séparés et se torturent mutuellement. L’homme est impuissant à dominer la femme, il ne comprend pas la nature féminine, n’en pénètre pas le secret. Il la voit seulement traverser sa vie comme l’incarnation de son propre dédoublement.
Le thème de l’amour dédoublé occupe une grande place dans l’œuvre de Dostoïevski. Il est particulièrement intéressant à étudier dans l’Idiot. Muichkine aime à la fois Nastasia Philippovna et Aglaé. Muichkine est un être pur, une nature angélique, affranchie du trouble courant de la sensualité. Pourtant son amour est un amour malade, frappé de dédoublement, tragiquement condamné à rester sans issue. Et l’objet de son amour se dédouble aussi. Ce dédoublement, c’est en vérité, au fond de lui-même, le heurt de deux principes contraires. Il est incapable de s’unir à Nastasia Philippovna, ou à Aglaé, inapte par essence au mariage, à l’amour conjugal. La beauté d’Aglaé le captive, et il serait prêt à la servir comme un fidèle chevalier. Mais, si les autres héros de Dostoïevski souffrent d’un excès de sensualité, Muichkine, lui, souffre d’en être complètement privé. Il n’a pas les sens d’un homme sain. Sa passion est privée de sang et de chair. Avec d’autant plus de force se développe chez lui le pôle opposé de l’amour, la pitié. Il aime Nastasia Philippovna avec une commisération, une compassion infinies. Compassion qui contient en soi un principe de destruction, car, par elle, Muichkine manifeste son arbitraire, il enfreint les limites de ce qui est permis à l’homme. L’abîme de sa pitié l’engloutit et le perd. Ce sentiment incomplet, né des conditions toutes relatives de cette terre, il eût voulu le transporter sur le plan de la vie éternelle. Il eût voulu imposer à Dieu sa pitié pour Nastasia Philippovna. Et au nom d’elle-même, au nom de cette compassion, il oublie ses devoirs envers sa propre personnalité. Car cette pitié ne réalise pas pour lui la plénitude, il ne s’y donne pas tout entier, non, il est affaibli par le dédoublement ; en cet instant même, il continue d’aimer Aglaé d’un tout autre amour. Dostoïevski montre ici comment une passion malsaine, une passion qui porte en soi la ruine, et non le salut, peut s’emparer d’un être pur, d’un être séraphique. Aucun élan, dans l’amour de Muichkine, vers un objet unique et complet, vers une union totale : cette pitié infinie, destructrice de l’être, ne peut être conçue que vis-à-vis d’une créature à laquelle jamais le destin ne vous unira. Ainsi déchirée, la nature de Muichkine est aussi une nature dionysiaque. Dionysisme d’une espèce particulière, taciturne, chrétien. On le voit constamment plongé dans une extase silencieuse, comme en un ravissement angélique. Et peut-être tous ses malheurs proviennent-ils du fait qu’il est trop pareil aux anges, qu’il est inapte à la condition humaine, qu’il n’est pas complètement un homme. Muichkine ne doit pas être rangé au nombre des types par lesquels Dostoïevski a voulu exprimer la condition de l’homme. Dans Aliocha, Dostoïevski a supposé l’être accompli qui, n’ignorant rien de ce qui est terrestre, portant en lui les passions fougueuses de l’homme, parvient à vaincre son dédoublement et à s’évader vers la lumière : ce caractère n’est peut-être pas, du reste, un des plus pleinement réussis de Dostoïevski. Au contraire, la figure extra-terrestre de Muichkine, à laquelle beaucoup de traits proprement humains sont inconnus, ne peut pas être considérée comme ayant résolu un aspect de la tragédie humaine. La tragédie de l’amour chez lui est transportée sur le plan éternel, et c’est par ce qu’il y a en lui de surnaturel que cette tragédie se perpétuera. Dostoïevski dote Muichkine d’un don étonnant de divination. Il prédit le destin de ceux qui l’entourent, pénètre jusqu’en leur profondeur les âmes des femmes qu’il aime, conciliant, en son être prophétique, les notions du monde sensible et du monde surnaturel. Mais ce don de divination est la seule emprise qu’il ait sur la nature féminine ; il est incapable également de la posséder et de s’unir à elle. Nous avons vu que les femmes, chez Dostoïevski, suscitent ou la sensualité ou la pitié, il arrive que la même femme suscite chez des hommes différents ces mouvements différents : c’est ainsi que Nastasia Philippovna éveille chez Muichkine une compassion infinie, chez Rogojine, une furieuse sensualité. Sonia, la mère de l’adolescent, évoque la pitié. Grouchenka, un lien sensuel. Les relations de Versilov et de Catherine Nicolaïevna sont d’ordre sensuel, alors qu’il aime sa femme avec sa pitié : la même sensualité existe dans les rapports de Stavroguine et de Lise, mais sous une forme déclinante, et comme étouffée. Ni la sensualité ni la pitié, par leur seule force, ne réuniront celui qui aime à l’objet de son amour. Le secret de la communion amoureuse ne réside ni en la pitié exclusive ni en l’exclusive sensualité, bien que ces deux éléments y aient leur part. Mais la communion amoureuse, le don nuptial, Dostoïevski ne le connaît pas : il ne connaît pas la fusion de deux âmes en une seule, de deux chairs en une chair. Et c’est pourquoi, chez lui, dès l’origine, l’amour est voué à la ruine.
L’interprétation de l’amour que donne Dostoïevski dans l’Adolescent, sous les espèces de l’amour de Versilov pour Catherine Nicolaïevna, est particulièrement intéressante. L’amour de Versilov est lié au dédoublement de sa personnalité. Il y a également en lui dédoublement de l’amour : d’une part, l’amour passion qu’il éprouve pour Catherine Nicolaïevna, de l’autre, l’amour pitié envers la mère de l’adolescent. Cet amour ne sera pas pour lui un moyen de s’échapper hors des limites de son « moi », de se tourner vers un autre « lui-même » et de s’unir à lui ; non, il apparaît comme une affaire intérieure entre Versilov et lui-même, comme un compte à régler avec son propre destin. La personnalité de Versilov est énigmatique pour tous ; il y a un secret dans sa vie. Dans l’Adolescent comme dans les Possédés, comme dans beaucoup d’autres œuvres, le procédé littéraire de Dostoïevski consiste à faire commencer l’action seulement après que s’est déroulé dans la vie de ses héros un fait particulièrement important, et qui doit influer sur une longue suite d’événements. L’événement important du roman de Versilov a eu lieu dans le passé, à l’étranger, et sous nos yeux s’en déroulent seulement les conséquences. La femme joue un rôle considérable dans la vie de Versilov. On le traite de « prophète pour femmes ». Mais il n’en demeure pas moins aussi inapte à l’amour conjugal que Stavroguine lui-même ; en vérité, c’est un proche parent de Stavroguine, un Stavroguine adouci et en pleine maturité. De l’extérieur, il paraît calme ; le volcan, semble-t-il, est refroidi. Mais sous ce masque de tranquillité, presque d’indifférence à l’égard de toute chose, se cachent en réalité des passions exaltées. L’amour secret de Versilov, impuissant à trouver une issue, voué au désastre, embrase l’atmosphère tout à l’entour, soulève des tourbillons. Cette passion celée plonge tous les autres personnages dans le délire. Ainsi, comme toujours chez Dostoïevski, la disposition intérieure d’un être, fût-elle même inexprimée, corrompt le milieu environnant. Les personnages qui entourent Versilov subissent dans leur inconscient l’influence de cette prodigieuse vie intérieure. Ce n’est que tout près du dénouement qu’éclate la passion de Versilov ; il accomplit alors une série d’actes insensés où se révèle le trouble de sa vie intérieure. La rencontre et l’explication de Versilov et de Catherine Nicolaïevna à la fin du livre comptent parmi les représentations les plus remarquables de la passion amoureuse. Non, le volcan n’était pas définitivement éteint. La lave de feu qui, sous-jacente au sol, avait créé dans toute l’œuvre une atmosphère étouffante, se précipite enfin. « Je vous perdrai », dit Versilov à Catherine Nicolaïevna, révélant ainsi l’élément démoniaque de son amour. Cet amour de Versilov est sans espérance et sans issue. Jamais il ne connaîtra les secrets et le mystère de l’union. L’homme restera éternellement séparé de la femme. Non que son sentiment ne soit pas réciproque : Catherine Nicolaïevna aime Versilov. Si cet amour est sans espérance, sans issue possible, il faut en chercher la cause seulement dans l’impénétrabilité de la nature masculine, dans son incapacité à s’évader vers un autre « lui », dans son dédoublement. La personnalité prodigieuse de Stavroguine, elle aussi, s’abîmera et se perdra définitivement par cette solitude et ce dédoublement.
Dostoïevski a étudié à fond le problème de la sensualité. La sensualité conduit à la débauche, qui est un phénomène d’ordre métaphysique, et non d’ordre physique. L’arbitraire de la volonté a engendré le dédoublement qui engendre cette débauche, où la personnalité humaine perd son unité. La débauche est en même temps le morcellement. L’homme dédoublé, morcelé, dépravé, s’enferme dans son « moi », perd toute faculté de s’unir à un autre objet ; le moi lui-même commence à se dissoudre ; ce n’est plus un être différent de lui-même qu’il cherche dans l’amour, mais l’amour seul. L’amour réel est celui qu’on éprouve pour un autre ; la débauche est l’amour de soi. La débauche est l’affirmation de soi. Et cette affirmation de soi conduit à la destruction de soi. Car c’est dans l’élan vers un autre être, dans la communion avec un autre être que la personnalité humaine se fortifie. La débauche au contraire est l’isolement le plus profond où la créature humaine puisse se plonger, l’isolement avec son froid mortel. C’est l’attirance du néant, la pente qui mène au néant. La sensualité est un fleuve de feu. Mais lorsque la sensualité devient luxure, le courant enflammé s’éteint, la passion se change en un froid de glace. Dostoïevski a montré ce processus avec une force stupéfiante. Dans le personnage de Svidrigaïlov, nous assistons à la dégénérescence ontologique d’une personnalité humaine, à la destruction de cette personnalité par une sensualité effrénée qui aboutit à une effrénée débauche. Svidrigaïlov [153] appartient déjà au monde illusoire du non-être, il y a en lui quelque chose qui n’est plus humain. Mais la dépravation toujours est née de l’arbitraire, de la menteuse affirmation de soi, du fait que l’homme se mure en lui-même et ne cherche pas à comprendre un autre être. La sensualité de Mitia Karamazov comporte encore une certaine chaleur, un cœur humain et ardent bat encore en lui : la luxure des Karamazov n’a pas encore atteint ici à cette région de froid glacial qui est un des cercles de l’enfer dantesque. Mais chez Stavroguine la sensualité a perdu toute ardeur, le feu s’est éteint, remplacé par un froid mortel. La tragédie de Stavroguine, c’est la tragédie d’une personnalité remarquable, et douée exceptionnellement, qui se dépense en folles aspirations, sans frein, sans choix et sans règle. Livré à l’arbitraire de sa volonté, il a perdu toute faculté de discernement. Et ces mots qu’il adresse à Dacha, dans une lettre qu’elle trouvera après sa mort, ont une résonance angoissante.
« J’ai essayé partout ma force, écrit-il… Quand je l’ai mise à l’épreuve, soit pour moi, soit que j’aie voulu en faire étalage, en toute occasion, et aujourd’hui comme autrefois, je l’ai toujours trouvée illimitée… Mais à quoi employer cette force, c’est ce que je n’ai jamais vu et ce que je ne vois pas encore… Je suis encore capable, comme cela m’est arrivé déjà, de vouloir accomplir une bonne action et d’en éprouver du contentement… J’ai pratiqué la débauche dans de vastes proportions, et [154] j’y ai épuisé ma force ; mais je n’aime pas la débauche, et ne l’ai pas désirée… Jamais je ne pourrai renoncer à mon jugement, croire en une idée au point où lui (Kirilov) peut y croire. Je ne puis pas même être occupé à ce degré par les idées. »
L’idéal du Bien et du Mal, l’image de la Madone et le gouffre de Sodome sont pour lui également attirants : cette impuissance à faire un choix, c’est précisément l’indice de cette aliénation de la liberté, de cette destruction de la personnalité qu’ont provoquées l’arbitraire et le dédoublement humain. La destinée de Stavroguine nous enseigne que désirer toute chose sans discernement, sans souci des limites qui définissent le contour de la personne humaine, équivaut à ne rien désirer du tout, et qu’une force démesurée, mais qui n’est tendue vers aucun but, équivaut à une faiblesse totale. Par son érotisme exaspéré et sans objet, Stavroguine aboutit à une véritable impuissance sexuelle, à l’incapacité absolue d’aimer une femme. Le dédoublement ne peut être vaincu que par le choix, que par un amour d’élection, un amour tendu vers un but défini, que ce soit Dieu, en écartant le diable, que ce soit l’image de la Madone, en rejetant Sodome, que ce soit enfin une femme donnée, unique, en écartant l’innombrable et mauvais troupeau des autres. La débauche, c’est l’impossibilité absolue de faire un choix entre les tentations qui vous sollicitent ; c’est le résultat de l’aliénation de la liberté et de l’équilibre de la volonté, la chute dans le néant par manque du courage nécessaire pour maintenir la réalité de son être. La débauche pour l’être humain représente la ligne de moindre résistance. Il convient de l’envisager, non du point de vue moral, mais du point de vue ontologique. C’est ce qu’a fait Dostoïevski.
L’empire des Karamazov est celui de la sensualité. Non pas cette sensualité concentrée sur un objet unique qui fait partie de tout véritable amour. Non, une sensualité dédoublée, qui est débauche, et en quoi s’incarne l’idéal du Mal. Chez les Karamazov, la personnalité humaine est annihilée ; Aliocha seul peut la retrouver, par le Christ. Livré à ses propres forces, l’homme ne serait pas capable de se sauver du néant.
Le vieux Fedor Pavlovitch Karamazov a définitivement perdu la possibilité de choisir librement. Le principe féminin, dans ses innombrables incarnations, le possède tout entier, le tient sous sa domination. Pour lui, il n’est plus de « femmes monstrueuses » ni de « laiderons » : à ses yeux, Elisabeth Smerdiatchaïa représente une femme… A ce degré extrême, le principe de l’individualité a définitivement disparu, la personnalité est anéantie. Mais la débauche qui tue la personnalité n’est pas un principe premier ; elle suppose avant elle une altération profonde dans l’édifice de cette personnalité. Elle est déjà l’expression de la désagrégation, le fruit de l’arbitraire et de l’affirmation de soi. Afin de les sauvegarder l’une et l’autre, l’homme doit nécessairement s’humilier devant un principe supérieur à son « moi ». La personnalité est liée à l’amour, mais à l’amour qui tend vers la communion avec un autre être. Au contraire, l’amour qui ne dépasse pas les limites du « moi » propre est l’amour qui engendre la débauche : en vain s’ouvrira l’abîme de la compassion, — l’autre pôle de l’amour — cette compassion-là ne sauvera pas la personne humaine, elle ne la délivrera pas du démon de la sensualité, car elle est elle-même sensualité. Sentiment incomplet, fragment mutilé de l’amour dédoublé, elle n’est pas cet élan total vers un autre où la personnalité pourrait retrouver son unité. Sans doute, la sensualité comme la compassion sont les deux courants éternels sans lesquels l’amour n’existe pas : la passion comme la pitié dispensées avec mesure et justifiées par l’objet aimé. Et surtout ces deux courants doivent être illuminés par la perception du visage aimé en Dieu, par la communion en Dieu avec l’être aimé. C’est là l’amour véritable. Mais Dostoïevski ne nous a jamais montré une réalisation heureuse de l’amour : le couple que forment Aliocha et Lise, le seul qu’il ait conçu dans un esprit optimiste, ne nous satisfait guère. Non, il ne faut pas chercher en lui l’idéal de la Madone, l’idéal du Bien. Mais il a apporté un tribut formidable à l’étude de la nature tragique de l’amour : c’est en cela qu’il a été vraiment un initiateur.
Le christianisme est la religion de l’amour. C’est essentiellement comme tel que Dostoïevski l’a compris. Dans les enseignements du starets Zosime, comme dans les autres considérations religieuses dispersées au long de son œuvre, on respire comme un souffle du christianisme de saint Jean. Le Christ russe, pour Dostoïevski, est avant tout le messager de l’amour infini. Mais la tragique antinomie que Dostoïevski avait révélée au fond de l’amour sexuel, il montre qu’elle existe aussi dans l’amour humanitaire, dans l’amour social. L’amour de l’homme pour son semblable et pour l’humanité peut être un amour impie, complètement étranger au christianisme. Dans l’étonnante vue de l’avenir que Dostoïevski met dans la bouche de Versilov, les humains se serrent les uns contre les autres et s’aiment mutuellement, parce que la grande idée de Dieu et de la vie éternelle qui les soutenait s’est obscurcie. « J’imagine, mon cher ami, dit Versilov à l’adolescent, le combat terminé. Après les malédictions, les sifflets et la boue, le silence est revenu ; et les hommes sont demeurés seuls, comme ils l’avaient désiré : la grande idée d’autrefois les a quittés ; le grand dispensateur de force, où si longtemps ils avaient puisé la nourriture et la chaleur, a disparu, comme disparaît un soleil immense au fond des toiles de Claude Lorrain : et l’on eût dit le dernier jour de l’humanité. Tout à coup, les hommes ont compris qu’ils demeuraient seuls, ils se sont sentis tout à coup complètement orphelins. Cher enfant, je n’ai jamais pu m’imaginer les gens comme des êtres ingrats et abêtis. Les hommes abandonnés se serreront aussitôt les uns contre les autres plus étroitement et plus tendrement ; ils se prendront par la main, comprenant que désormais ils représentent les uns pour les autres tout l’univers. Car la grande idée de l’immortalité aura disparu et, pour la remplacer, les hommes reporteront sur le monde, sur la nature, sur leurs semblables, sur chaque brin d’herbe, le trop-plein d’amour qu’ils consacraient jadis à la vision de la vie éternelle. Ils chériront la terre et la vie avec frénésie et dans la mesure où, graduellement, ils s’habitueront à y voir leur origine et leur fin ; ils les chériront d’un amour particulier, non plus le même qu’autrefois. Ils observeront et découvriront dans la nature des phénomènes et des mystères jusque-là insoupçonnés, car ils regarderont le monde avec des yeux neufs, comme l’amant regarde sa bien-aimée. Ils s’éveilleront et se hâteront de s’étreindre les uns les autres, sachant que leurs jours sont comptés, et que c’est tout ce qu’ils ont. Ils travailleront les uns pour les autres, chacun donnant à tous son salaire et n’étant heureux que par ce don. Tout enfant saura que dans toute créature terrestre il peut trouver un père ou une mère. Car chacun pensera, contemplant le soleil couchant : Demain peut-être sera mon dernier jour. Mais qu’importe ? D’autres resteront lorsque je ne serai plus, et après eux leurs enfants. Ainsi ils seront soutenus, non plus par l’espoir d’une rencontre d’outre-tombe, mais par la pensée qu’après eux d’autres créatures les remplaceront sur cette terre, toujours s’aimant et frémissant les uns pour les autres. Oh ! ils se hâteront d’aimer pour étouffer au fond de leur cœur leur chagrin profond. Pour eux-mêmes, ils seront fiers et hardis, mais se feront timides les uns pour les autres. Chacun tremblera pour la vie et le bonheur de son prochain. Ils seront tendres mutuellement sans en éprouver de gêne, et se caresseront comme des enfants. Et, en se rencontrant, ils se jetteront l’un l’autre un regard profond et chargé de sens, un regard rempli à la fois d’amour et de douleur. »
Versilov a voulu tracer, dans cet étonnant passage, le tableau de l’amour sans Dieu, aux antipodes de l’amour chrétien, de l’amour qui ne procède pas de l’essence de l’Etre, mais d’une dérision de l’Etre, non d’une affirmation de la vie éternelle, mais de l’utilisation de l’instant éphémère de l’existence. Ce n’est qu’une fantasmagorie. Car l’humanité sans Dieu ne connaîtrait pas un tel amour, son sort serait plutôt celui que Dostoïevski a décrit dans les Possédés. Mais, telle qu’elle est, l’utopie de Versilov est intéressante en ce qu’elle développe les idées de Dostoïevski sur l’amour. L’humanité athée doit aboutir à la férocité, à l’entr’égorgement ; [160] elle doit ramener l’homme à l’état de simple moyen. On aime son semblable en Dieu : un tel amour affermit en chaque être la notion de l’éternité ; seul il est l’amour véritable, l’amour chrétien, lié à l’immortalité de l’âme, affirmation de cette immortalité. Voilà la pensée essentielle de Dostoïevski. L’amour véritable est lié à la personnalité, la personnalité est liée à l’immortalité de l’âme. Cela est vrai pour l’amour sexuel comme pour toute autre forme de l’amour humain. Il existe un autre amour qui s’adresse à l’homme en dehors de Dieu, qui méconnaît en l’homme l’aspect éternel, seul perceptible en Dieu, enfin qui n’est pas dirigé vers la vie éternelle. C’est un amour impersonnel, collectif, qui pousse les êtres à s’agréger les uns aux autres, afin qu’il leur soit moins effrayant de vivre, ayant perdu la foi en Dieu et en l’immortalité, c’est-à-dire dans le sens de la vie. Cet amour-là est le dernier terme de l’arbitraire humain et de l’affirmation de soi. Par un tel amour, où Dieu n’a pas de part, l’homme renie sa nature spirituelle, la primauté de son origine, il trahit la liberté et l’immortalité. Sa compassion envers son semblable, comme envers une créature faible et pitoyable, jouet de la nécessité aveugle, c’est encore le dernier refuge de son idéalisme, au-delà duquel toute idée est abolie, la Raison même se perd. Mais cette compassion n’est déjà plus une compassion chrétienne. Dans l’amour chrétien, tous les hommes sont frères en Christ. Et l’amour en Christ, c’est la perception de la filiation [161] divine de chaque individu, fait à l’image et à la ressemblance de Dieu. L’homme doit avant tout aimer Dieu. Voilà le premier commandement. Le second est d’aimer son prochain. Il n’est possible à deux créatures de s’entr’aimer que parce que Dieu existe, leur Père commun. C’est la forme et la ressemblance divine qu’on chérit en son semblable. Aimer l’homme, si Dieu n’existe pas, signifie qu’on déifie l’homme, qu’on le vénère comme Dieu. Dangereuse conception de l’Homme-Dieu qui nous guette, et qui doit dévorer l’individu, l’asservir. Aimer l’homme en dehors de Dieu est donc impossible : c’est pourquoi Ivan Karamazov déclare qu’on ne peut aimer son prochain. La notion du Surhomme, de l’homme divinisé est fatale à l’humanité : l’idée contraire, l’idée du Dieu qui descend parmi les hommes, qui devient homme, lui est seule secourable, et l’affermit en vue de la vie éternelle.
L’amour athée, antichrétien, forme le thème principal de la Légende du Grand Inquisiteur. Nous y reviendrons. Dostoïevski a abordé plusieurs fois ce sujet : la négation de Dieu au nom de l’eudémonisme social, au nom de l’humanitarisme, au nom du bonheur des hommes en cette courte vie terrestre. Et chaque fois il a proclamé comme nécessaire l’union de l’amour et de la liberté. Or, pour lui, cette union n’est réalisée que dans la figure du Christ. L’amour de l’homme et de la femme, l’amour de tout homme envers son prochain devient un amour impie sitôt qu’il s’est dépouillé de sa liberté spirituelle, sitôt que s’est obscurcie en lui la vision de l’immortalité et de l’éternité. L’amour véritable est l’affirmation de l’éternité.