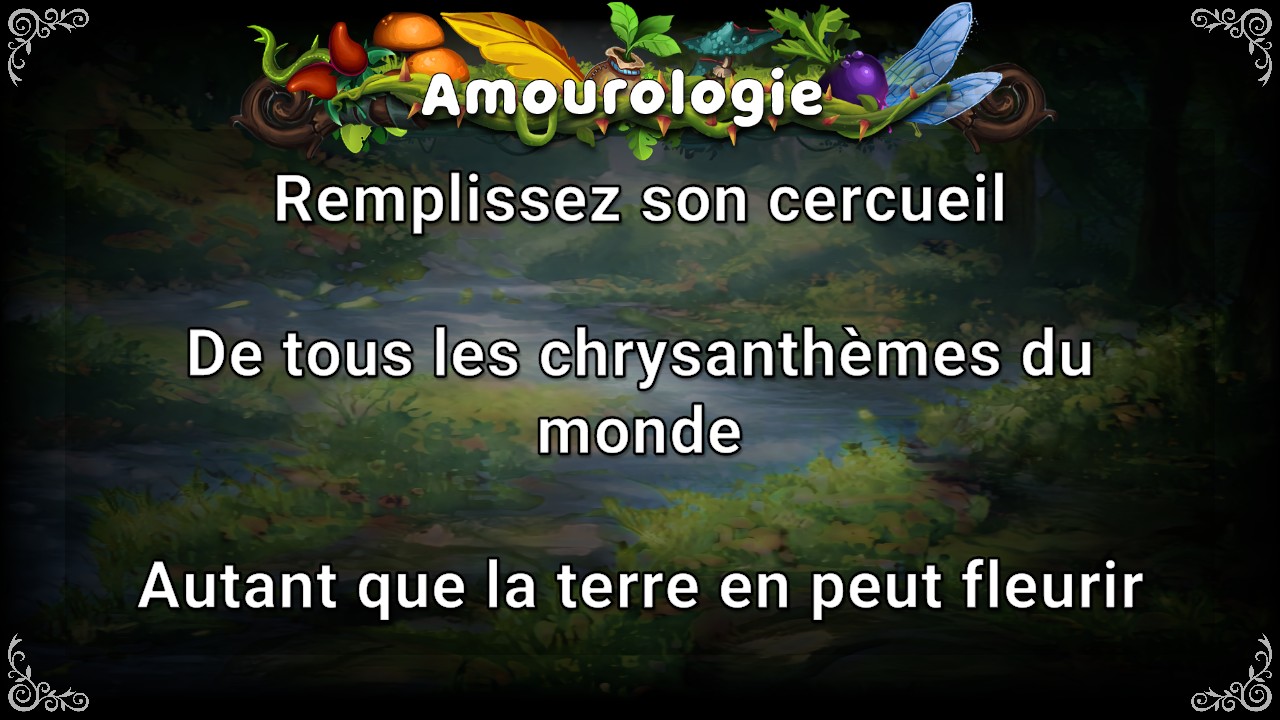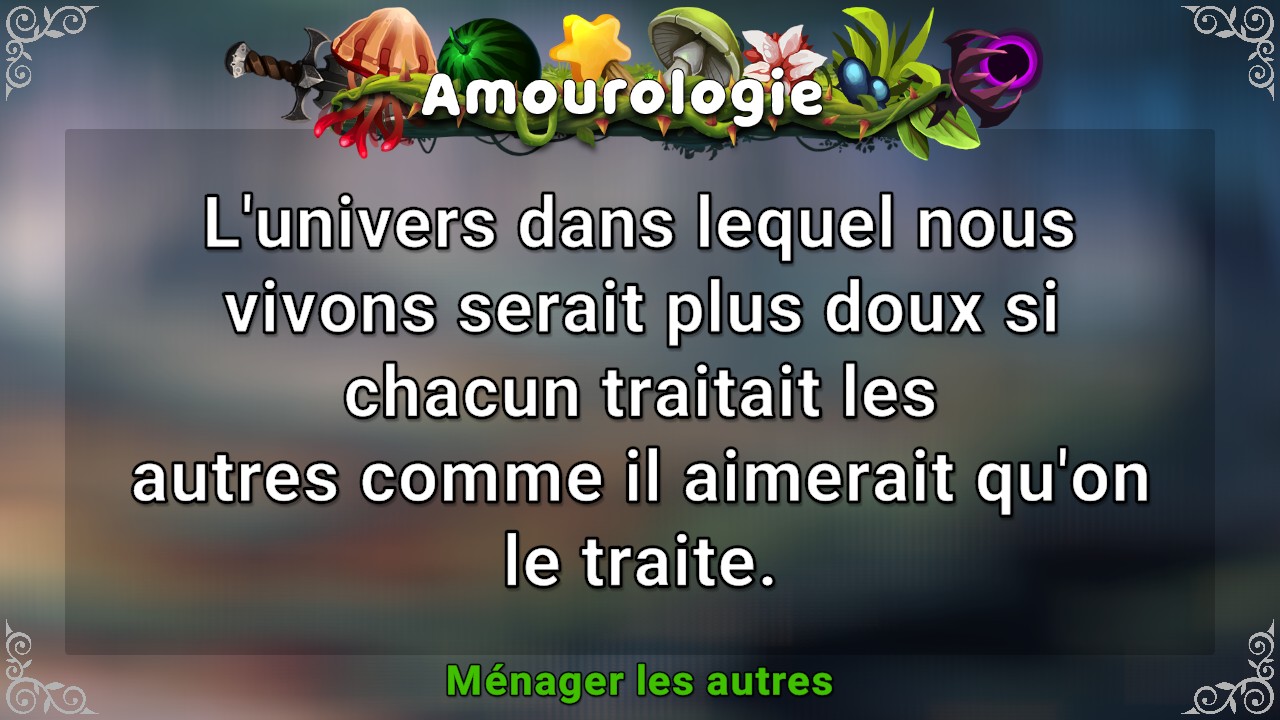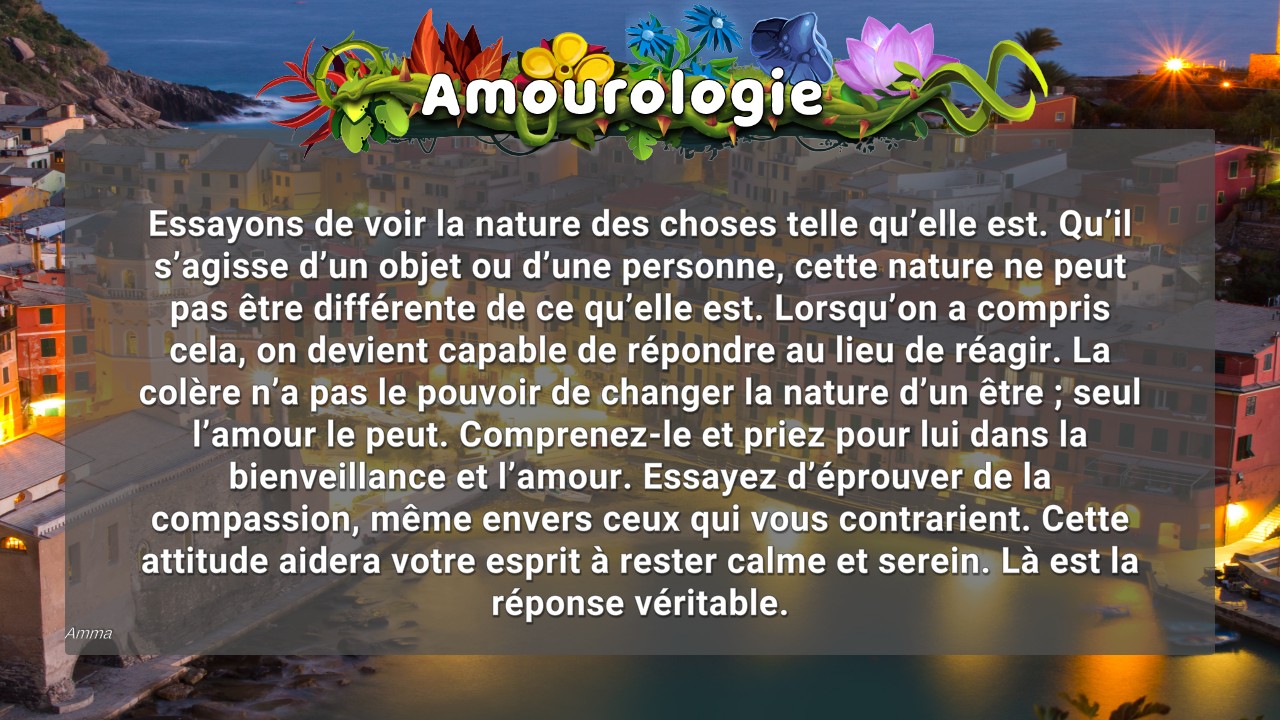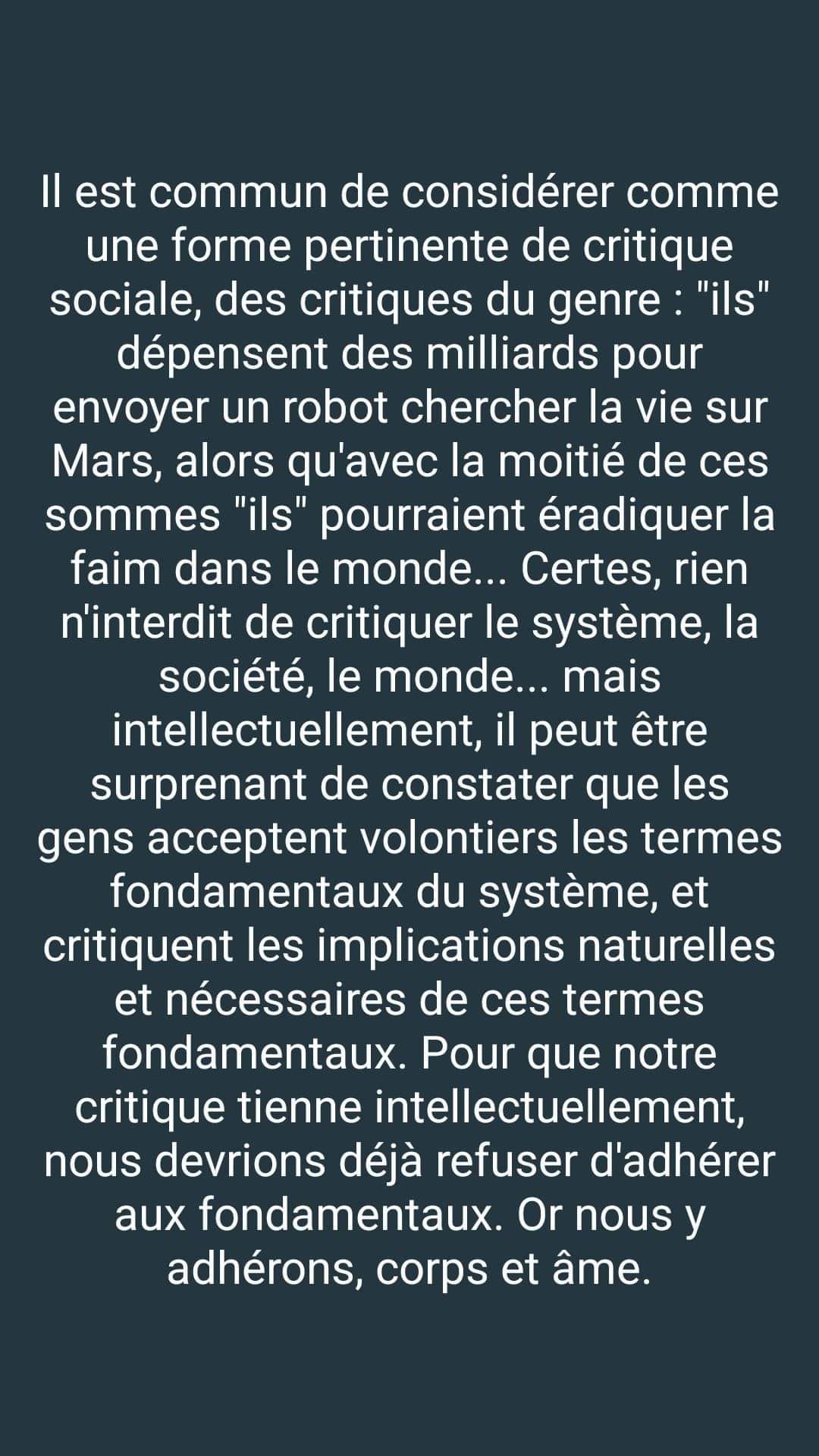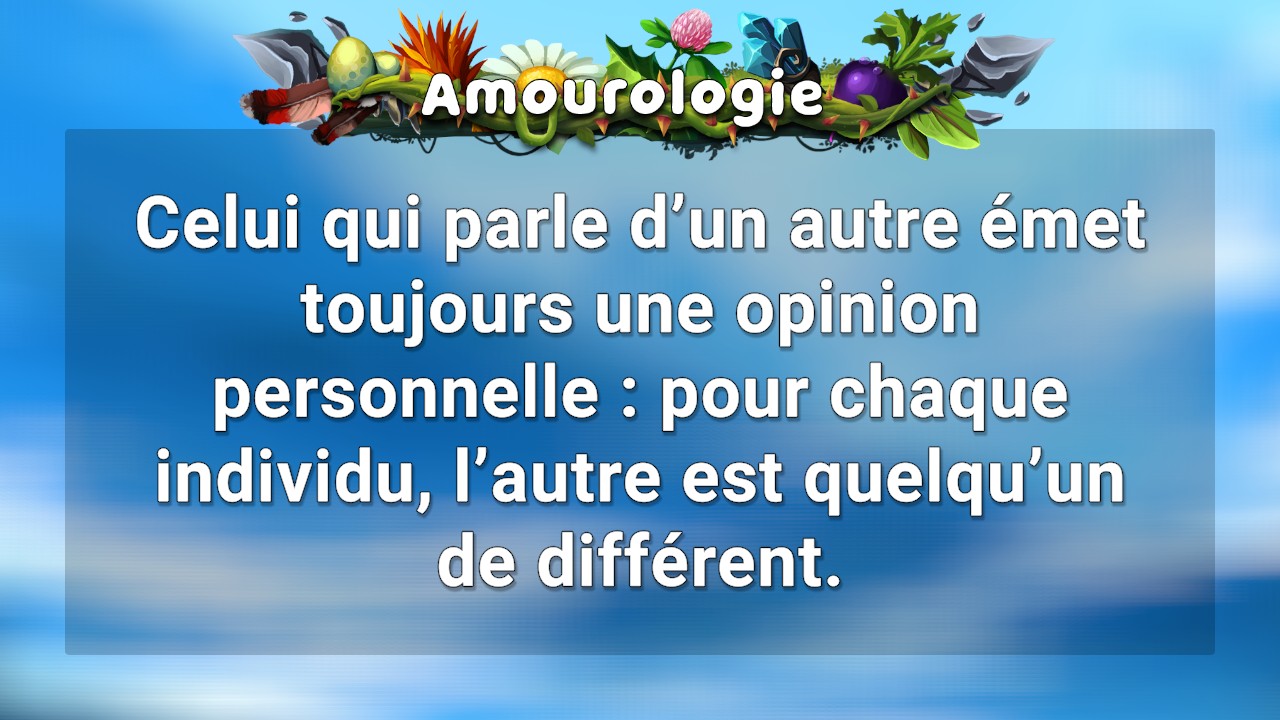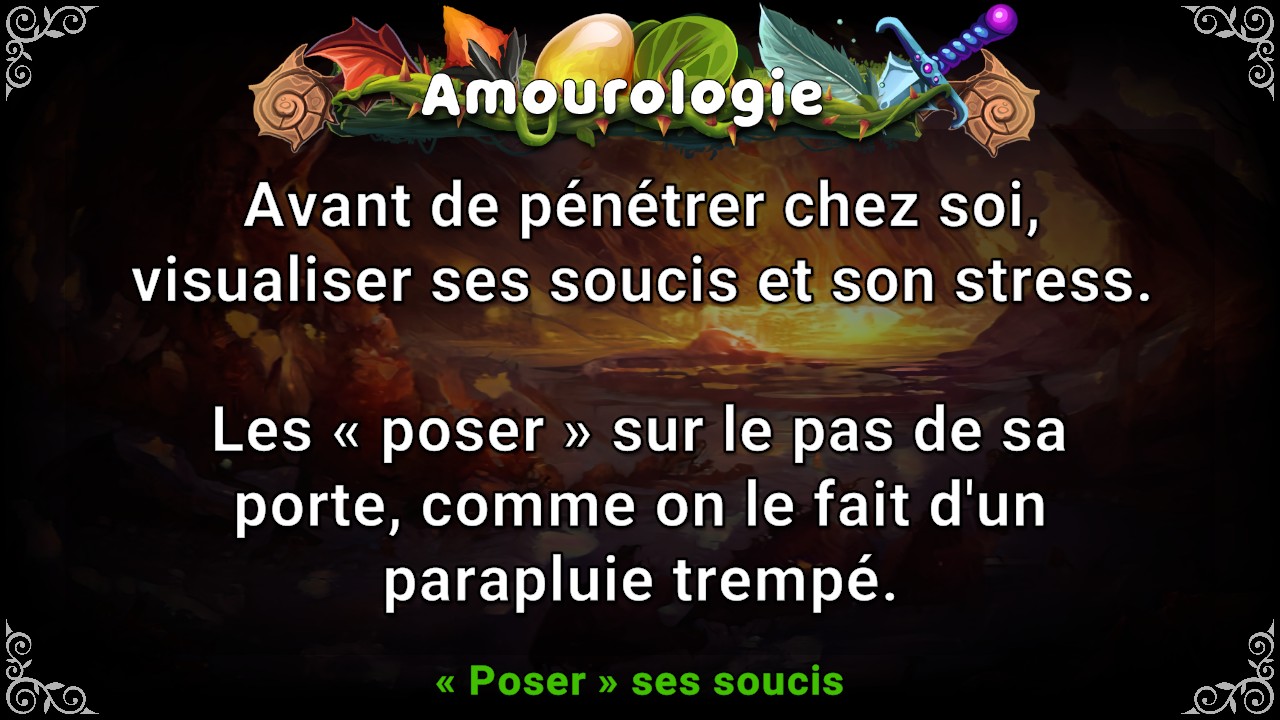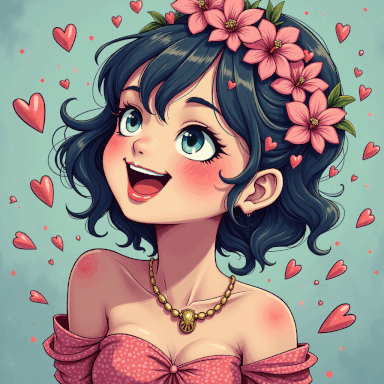
le mariage jure fidélité jusqu’à la mort
pourtant dans les millieu religieux
on a tendance a se dire que
l’amour est plus fort que la mort.
c’est un message d’espoir
qui signifie coute que coute
qu’on continue a aimer
nos proches après leur mort
.
Traducteur: Paula Nuñez
Relecteur: Hélène Vernet
Il était une fois un monde bleu.
Tout était bleu sauf
un point, un point rose.
C’est ainsi que ma fille,
Carla Marie, se décrivait
dans une histoire qu’elle écrivit
et illustra à neuf ans :
un point rose détonant
dans le monde bleu de la vie.
Et détonante, elle l’est !
Précoce, hypersensible,
d’une vitalité débordante,
toujours prête à s’émerveiller,
à aider les autres et à voir dans l’amour
la cause fondamentale de toute chose
- un amour si fusionnel que
toutes nos séparations
se vivent comme une déchirure.
Et, en conclusion
de son histoire, elle dit :
« Finalement, elle était bien
dans son bleu
et elle y vécut très heureuse. »
Et nous vivons très heureux dans son bleu,
son papa, sa sœur et moi,
jusqu’au 22 octobre 2014.
Ce jour-là, notre vie bascule.
Les urgences pédiatriques
du C.H.U. de la Timone
descellent une lésion du tronc cérébral
sur l’I.R.M. qu’ils ont pratiqué
sur Carla Marie.
Ils nous annoncent
qu’on doit passer la nuit
pour faire des examens complémentaires.
Les examens sont rassurants, concluant
à une simple origine inflammatoire,
avant de conclure deux mois plus tard,
à un gliome infiltrant du tronc cérébral,
une tumeur de l’enfant inopérable,
incurable, très agressive,
ne lui laissant une espérance de vie
que de dix-huit mois au mieux,
et certainement beaucoup moins.
Carla Marie devient alors,
pour le milieu médical, un cas perdu,
un cas tellement difficile à vivre
que tout le monde aimerait
déjà l’oublier comme un échec.
Deux mois plus tard, Carla Marie s’éteint
dans la nuit, à 1 heure
du matin, à l’hôpital,
après deux mois d’hospitalisation.
Un quart d’heure après son dernier
souffle, le médecin de garde
vient constater le décès
sans un mot, sans un regard,
et on nous demande
si on a prévu la tenue.
Je ne comprend pas ces mots.
Quelle tenue aurais-je dû prévoir ?
Les parents ne prévoient jamais
la mort de leur enfant.
Jusqu’au dernier souffle,
ils espèrent le miracle.
Alors, on l’habille de mes vêtements
et puis on nous annonce que
les brancardiers vont venir la chercher
pour la conduire au funérarium,
où nous devrons attendre 8 heures
pour la revoir ensuite.
On reste un moment immobiles, incrédules,
avec son papa dans la chambre,
après que les brancardiers
l’ont emmenée sur leur chariot.
Puis, la porte s’ouvre et on nous demande,
un peu gênés et poliment,
de combien de temps on a besoin
pour rassembler nos affaires,
avant l’équipe de relève de 5 heures,
pour refaire la chambre.
Alors, on quitte la chambre.
On regarde une dernière fois le nom
écrit sur la porte au feutre Velleda,
et on attend dehors, sur un banc,
l’ouverture du funérarium.
Alors, à la souffrance indicible
de la perte de notre fille
s’ajoute un sentiment d’abandon.
Notre fille n’a manqué de rien
d’un point de vue médical.
Elle a même eu droit
à un traitement exceptionnel.
Mais est-ce juste de médical
dont on a besoin
quand on vit la fin de vie de son enfant ?
L’hôpital n’est pas un lieu
fait pour mourir,
pour personne, et encore
moins pour un enfant.
Il existe un décalage entre
ce qui se joue pour des parents
et pour le personnel soignant.
Les priorités ne sont pas les mêmes.
Pour les parents,
c’est se donner en accéléré,
tout l’amour que toute une vie
ne suffirait pas à se donner.
Pour le personnel soignant,
c’est vivre au plus vite et oublier
ce qu’ils ne perçoivent que
comme souffrance et échec.
Pourtant, les derniers mois passés
auprès de Carla Marie
ont été les plus durs
de toute notre existence
mais aussi les plus forts,
les plus intenses.
Ce qui se jouait était si fort
en termes d’amour
que parfois, c’était même
comme d’un autre monde.
C’était un océan d’amour
qui réussissait à prendre le pas
sur toute l’horreur de la situation.
Et c’est aussi ce que rapportent beaucoup
de professionnels de soins palliatifs
qui parlent
d’un enrichissement réciproque,
de moments de vie ultimes et beaux
au chevet des patients en fin de vie.
Pourtant, il n’existe pas d’Unité
de Soins Palliatifs en pédiatrie
dans nos hôpitaux français,
et les centres de soins
palliatifs existants sont réticents,
quand ils ne refusent pas
d’accueillir des enfants.
Il n’existe pas d’accompagnement
des familles vivant ces épreuves,
ni de soutien au personnel soignant
tout aussi durement éprouvé,
aucun accompagnement
à la mesure du cataclysme
que représente la fin de vie d’un enfant,
ni aucune prise en charge à la mesure
de l’amour ultime qui se joue
dans ces moments-là.
Pourtant, un enfant décède
tous les jours du cancer en France,
et on compte plus de 4 000 décès
d’enfants par an.
Ce que l’on se représente
comme la chose la plus inconcevable,
la perte la plus inconcevable,
frappe donc 4 000 familles par an.
Alors pourquoi nous
ne les accompagnons pas mieux ?
Et pourquoi ce vide ?
Parce que la mort d’un enfant est
si impensable qu’elle est impensée.
Parce que sitôt arrivée, le meilleur moyen
que l’on trouve pour y faire face,
c’est de l’oublier.
Pourtant, les conséquences de la mort
d’un enfant doivent être pensées
parce qu’elles sont une réalité
et qu’elles touchent un cercle
bien plus large que les seuls parents.
Les fratries, souvent
sur plusieurs générations,
les camarades de classe,
les enseignants de l’enfant,
tout le personnel soignant,
personne ne se sort indemne
de ce véritable traumatisme
et pourtant, tout le monde essaie de faire
comme si cela n’était pas arrivé
ou n’arrivait pas.
Alors, les parents vivent la double peine
de la perte de leur enfant et du déni.
Ils se sentent dérangeants,
fuis et presque honteux
parce qu’il est honteux
de vivre un tel destin,
parce que, forcement,
on doit être un peu maudit
pour ainsi être frappé par la fatalité.
Parce qu’on fait peur et parce qu’on
rappelle à nous-mêmes chaque fois,
ce que tout le monde voudrait oublier :
la mort possible d’un enfant.
Alors, non seulement
on n’accompagne pas les parents,
mais en plus,
quelques mois après le décès,
notre société intime
aux parents de faire le deuil,
comme une invitation à passer
à autre chose, à tourner la page,
à prendre sur soi, à ménager les autres.
Mais, de qui se soucie-t-on vraiment
quand on encourage
un parent à faire le deuil ?
De l’équilibre psychique du parent,
ou de soi-même ?
Qui a le plus d’intérêt à oublier
cette mort contre nature ?
Le parent condamné à vivre avec ?
Ou son entourage
qui aimerait ne plus y penser
pour retrouver son insouciance d’avant ?
Alors, si faire le deuil
veut dire oublier,
c’est juste impossible pour des parents.
Parce qu’après la perte de leur enfant,
le plus difficile et le plus
insupportable, c’est son oubli.
Alors, quelle ressource
apporter à ces familles ?
Comment les aider sans
se mettre soi-même en danger ?
Parce qu’on est tous démunis
face à un tel malheur.
On a tous la tentation de la fuite
parce qu’on ne sait pas quoi dire,
parce qu’on a peur d’être maladroits,
parce qu’on a peur
de ne pas être à la hauteur.
Mais la maladresse n’est rien
à côté de la fuite,
qui sera forcement vécue par les parents
comme un déni de leur malheur.
Il faut oser en parler pour sortir
les parents de leur isolement
et pour s’aider soi-même à vivre
ce que l’on ne veut pas vivre.
Mais, que dire ?
En vérité, il s’agit moins de dire
que d’écouter,
montrer de la considération
pour l’enfant en fin de vie
parce que la fin de vie, c’est encore
de la vie et de la vie ultime,
montrer de la considération
pour les parents,
pour le malheur qui est le leur,
sans les fuir,
sans faire comme si de rien n’était,
être là, juste présent et bienveillant.
Alors, quelle ressource
apporter aux parents ?
Eh bien, la reconnaissance d’abord.
Ensuite l’amour,
parce que l’amour est bien
la ressource ultime
pour vivre la fin de vie d’un enfant
et lui survivre après
- l’amour des autres bien sûr,
mais aussi l’amour de son enfant,
encore et toujours.
Parce que la mort de l’enfant,
ce n’est pas la fin de la vie
ni, surtout, la fin de la vie
avec lui pour la famille.
Les parents perdent leur enfant
mais pas l’amour de leur enfant
qui continue à vivre en eux.
Alors, acceptons que même
si l’enfant n’est plus,
les parents continuent à en parler,
à lui faire une place,
sans les fuir,
sans les juger dérangeants.
Et dérangeants,
ils le seront forcément
en parlant de leur enfant défunt,
en partageant ses photos,
en fêtant son anniversaire,
en faisant de son lieu de sépulture
un lieu plein de couleurs.
Mais il ne faut pas y voir un comportement
pathologique et mortifère,
mais bien plutôt un lien d’amour
qui perdure au-delà de la mort.
Ce lien, c’est bien
la clé de la résilience :
faire une place à l’enfant pour
qu’il ne prenne pas toute la place,
c’est l’enjeu de l’accompagnement
des familles orphelines d’un enfant.
Je me répète souvent, comme un mantra,
une phrase que Carla Marie
m’a dite un jour, à 8 ans.
Elle m’a dit :
« Maman, derrière chaque malheur
se cache un petit bonheur. »
Derrière le grand malheur
de la perte d’un enfant
se cache ce petit bonheur
de l’amour plus fort que la mort.
Un jour, quelqu’un m’a dit
que mon histoire décuplait
son envie de vivre et partager.
C’est ce à quoi l’on s’expose en s’ouvrant
à nous, parents orphelins d’un enfant,
non pas parce que
notre malheur vous aidera
à vous sentir chanceux de votre propre
bonheur ou absence de malheur,
mais parce que vous puiserez
dans notre vécu de ce malheur,
l’immense espoir d’un amour
plus fort que la mort.
Six mois après le décès de Carla Marie,
nous avons créé
l’association Le Point Rose
pour développer les soins
palliatifs pédiatriques,
pour accompagner les personnes
confrontées à la fin de vie d’un enfant,
pour les aider à vivre ces moments
d’amour ultime à son chevet,
et à trouver une forme
de résilience après, dans l’amour
- un point rose pour trouver les petits
bonheurs derrière le grand malheur,
un point rose pour ajouter
de la vie aux jours
quand on ne peut
ajouter de jours à la vie,
pour rendre le bleu autour,
plus bleu et plus profond,
pour décupler l’envie
de vivre et partager.